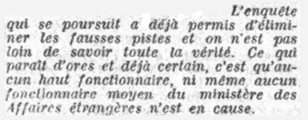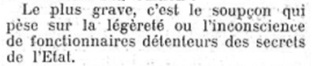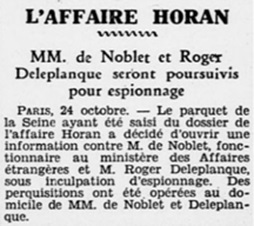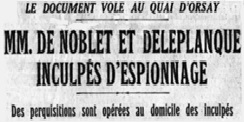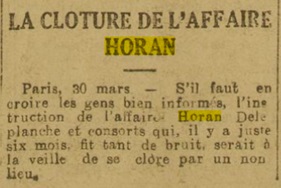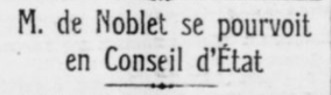Alexis Leger and the Horan Affair
Prolégomènes
Quel est le contexte et quelles les circonstances ?
The 6 February 1922, à Washington, avait été signé, par les représentants de neuf pays, United States, Grande-Bretagne, Japan, China, Italy, Pays-Bas, Portugal, Belgique et France, un traité limitant leurs armements maritimes. Il avait été préparé par une conférence qui les avait réunis à partir du 12 November 1921.
La délégation française était conduite par Aristide Briand, Ministre des Affaires étrangères, assisté de Philippe Berthelot, Secrétaire général du Ministère. Entre autres personnalités, Alexis Leger, tout juste rentré de Chine, avait été invité par Berthelot à se joindre à la délégation comme « expert politique sur la limitation des armements et les questions d’Extrême-Orient[1] ».
On sait l’importance pour Leger de cette première rencontre avec Briand. Les deux hommes ne se quitteront plus, Briand jusqu’à sa mort n’aura pas de collaborateur plus fidèle, Leger lui devra en grande partie sa carrière.
 Aristide Briand et Alexis Leger en 1921
Aristide Briand et Alexis Leger en 1921
The 25 November 1921, avant la fin de la conférence, Briand a quitté l’Amérique, laissant au sénateur René Viviani, ancien Président du Conseil et ancien Ministre des Affaires étrangères, la mission de signer le ou les traités auxquels la conférence aura abouti. Briand a fait en sorte que Leger revienne avec lui.
Un seul traité a été signé à l’unanimité des pays représentés, appelé le « traité des neuf puissances ». Il limite le tonnage et l’armement des navires de guerre mais ne dit rien de leur nombre. Pour les questions qui n’avaient pas fait l’unanimité, deux commissions de quatre et cinq membres ont été installées, à charge pour ceux-ci de faire évoluer le texte et de s’entendre entre eux sur un texte acceptable par tous.
La commission qui nous intéresse, forte de cinq membres, avait à discuter du nombre et de la nature des armements navals, c’est-à-dire des armes dont sont équipés les navires de guerre. Elle était composée de représentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l’Italie et de la France. Les principaux négociateurs côté français étaient Philippe Berthelot, Joseph Paul-Boncour, député, Président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et Georges Leygues, le Ministre de la Marine.
Dans les mois et années qui vont suivre, la presse de loin en loin va évoquer sans passion l’avancée des travaux de cette commission, ou les difficultés rencontrées. À l’été 1926 for example, Geneva, les discussions ont été bloquées par l’intransigeance de l’Angleterre, a-t-on dit alors, à cause de celle des États-Unis, a-t-on dit aussi, mais elles avaient repris au début de 1928.
Le compromis naval franco-britannique (summer 1928)
Signe qu’à l’été 1928, tout allait apparemment pour le mieux, la France et le Royaume-Uni ont adopté un compromis naval, concrétisé par trois notes échangées entre les deux pays. La dernière, from June 28 July, présentait une synthèse générale des échanges et constituait le compromis proprement dit.
Ces documents n’avaient pas vocation à être publiés or, dès le 30 July, London, à la Chambre des Communes, the Secrétaire d’État au Foreign Office, Austen Chamberlain, qui avait participé aux discussions côté anglais, a non seulement révélé l’existence de ce compromis mais a partiellement levé le voile sur son contenu. Il l’a fait en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’un compromis, d’un document de travail, d’une proposition à soumettre aux trois autres puissances membres de la même commission, les États-Unis, le Japon et l’Italie, non d’un accord à proprement parler.
La presse pourtant a plutôt utilisé le terme accord.
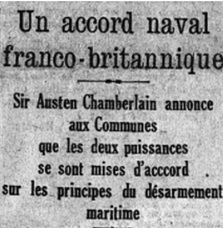 Titre du journal Morning from June 31 July 1928,
Titre du journal Morning from June 31 July 1928,
reprenant l’article de l’Evening Standard de la veille.
Des tensions en ont aussitôt résulté, spécialement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, en rapport avec le caractère prématuré de la publication d’informations (le texte n’en avait pas encore été communiqué aux autres membres de la commission) puis très vite, en rapport avec son contenu. Mais ces tensions n’ont pas dégénéré en crise diplomatique du fait, especially, qu’après les accords de Locarno (1925) allait être signé, fin août, Paris, le pacte Briand-Kellog par lequel soixante-trois pays « condamn[aient] le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renon[çaient] en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles[2] ». La divulgation prématurée d’informations sur le compromis naval franco-britannique pesait peu par rapport à de tels enjeux.
À l’origine de l’affaire : la publication aux États-Unis de la circulaire Berthelot
(20 September 1928)
Depuis la révélation, fin juillet 1928, par Chamberlain, de l’existence de ce compromis, la presse a, en France comme ailleurs, réclamé que le texte officiel en soit publié. Un article publié dans le New York American, the 20 September 1928, a en partie répondu à cette attente.
In fact, l’article n’a pas, comme espéré, reproduit le texte même du compromis mais une circulaire de Philippe Berthelot à son sujet, en date du 3 août, adressée par la Direction des Affaires politiques et commerciales aux ambassadeurs en poste à l’étranger. À la tête de cette Direction, Gaston Corbin et son adjoint, Alexis Leger. Le Secrétaire général du Quai d’Orsay y faisait le point sur les discussions en une sorte d’aide-mémoire à usage interne.
On s’est d’abord presque exclusivement préoccupé de son contenu et non des moyens par lesquels il était tombé entre les mains du journaliste.
En Europe, le document a été présenté et analysé (mais non intégralement reproduit) le lendemain, 21 September, London, dans l’Evening Post, et le jour suivant, the 22, à Paris dans Morning avec en titre ce commentaire : « L’adhésion des États-Unis n’est pas probable ». Shortly, quand le Président Coolidge et son Secrétaire d’État Kellogg se seront exprimés, le refus des Américains de se joindre au compromis sera avéré.
Le Japon donnera son accord, pas l’Italie, mais tel est le jeu diplomatique : on traverse certes une période de tension mais il n’y a toujours rien en l’occurrence qui constitue une affaire, un scandale.
Il en ira autrement quand on s’interrogera sur l’origine de la fuite. « Comment ce document français s’est-il trouvé en possession du New York American ? » s’était demandé Le Petit Parisien dès le 22 September. Son hypothèse est que le document a été sorti du coffre-fort d’une des ambassades[3].
Au Quai d’Orsay, on semble valider l’idée. L’enquête administrative immédiatement lancée « sera poussée activement mais il est évident qu’elle prévoit de grosses difficultés étant donné le grand nombre de copies existantes de la circulaire divulguée dont beaucoup de postes avaient reçu communication[4] ».
Un journaliste de The Uncompromising confirme. Il a appris au Ministère que la circulaire de Berthelot a été « tirée au ronéo et envoyée à Washington, à Rome et à Tokyo mais aussi pour information à d’autres postes diplomatiques et même à Genève », et non pas aux seules ambassades françaises, dès lors « il est bien difficile de savoir d’où [le document] est parti, où il a été soustrait, où il a été volé[5] ». Le journaliste qui suit la question pour The Uncompromising est un certain Roger Deleplanque.
Plusieurs journaux ont laissé entendre que le document pouvait être un faux mais l’Angleterre puis la France ont confirmé son authenticité.
Comme le document a été publié par un journaliste étranger en poste à Paris, un certain Harold T. Horan, il est apparu très vite que c’est à Paris, au sein du ministère des Affaires étrangères, qu’il fallait enquêter et non du côté des ambassadeurs ni ailleurs.
La presse s’est emparée du sujet, la question de l’existence et de l’identité d’un informateur au sein du Ministère s’est faite de plus en plus présente et pressante au fil du temps.
« Qui a communiqué [le document] to New York American ? À qui l’a-t-on soustrait[6] ? ».
« D’où vient la fuite ? Comment cette lettre adressée à des ambassadeurs a-t-elle pu tomber entre les mains de la Presse ?[7] ».
À en juger par le nombre des articles qui sont consacrés à la question de la fuite, ce point précis intéresse le public au moins sinon plus que le contenu du texte. Il n’est guère que Le Populaire pour soutenir que « ce n’est pas cela qui intéresse l’opinion publique justement émue par les révélations américaines[8] ». Ce faisant, le journal exprime un souhait et non une réalité.
Harold T. Horan, Chef de l’agence parisienne de l’International News Service et correspondant à Paris du New York American, a été très vite convoqué au Quai d’Orsay et il semble bien que dès le 23, l’enquête était bouclée puisque on en était déjà au chapitre des sanctions. Humanity en effet, ce même jour, croit savoir que le journaliste américain « allait être invité à quitter le territoire français ».
L’agence International News Service, de même le New York American, étant la propriété, avec beaucoup d’autres journaux, de Randolph Hearst, le très francophobe magnat de la presse américaine[9], il est évident que le but de la publication du document a été de faire capoter la négociation en cours et d’empêcher que les États-Unis ne rejoignent l’accord franco-britannique. Le titre de l’article de Horan était tout sauf neutre :
Deux nations d’accord contre les États-Unis. Une lettre du ministère français des Affaires étrangères montre qu’on a fait fi des considérations américaines relatives aux croiseurs et aux canons[10].
Toute la presse française le répète :
Que cette publication faite par un journal américain constitue une suprême manœuvre pour essayer de faire échec au compromis franco-britannique, c’est évident[11].
Paul Cambon, qui jusqu’en 1920 avait été l’ambassadeur de la France à Londres, exprime la même idée presque dans les mêmes termes :
Cette publication ne visait de toute évidence qu’à tenter une pression suprême en vue de faire échec à l’accord franco-britannique[12].
Les milieux officiels anglais avancent pourtant une tout autre hypothèse quant au but poursuivi, assortie d’une accusation gravissime contre la France. In Paris, seul Le Populaire en fait tardivement état, pour la contester :
C’est le gouvernement français lui-même qui a fait le nécessaire pour que le document diplomatique confidentiel tombe entre les mains de M. Hearst et soit publié dans ses journaux. […] Le dessein du gouvernement, ou au moins du Ministre des Affaires étrangères, était, en rendant les clauses du ‘compromis’ publiques, de contraindre la Grande-Bretagne à s’y tenir strictement en dépit de l’hostilité manifeste des États-Unis[13].
Le but aurait donc été non pas de faire échouer l’accord mais au contraire de forcer la Grande-Bretagne à l’accepter. L’idée est répétée, et à nouveau contestée, dans le même journal le 5 th 1928 :
Le bruit a couru en Angleterre dans les milieux les plus officiels que la presse Hearst tenait le document du gouvernement français lui-même, et que par cette indiscrétion calculée, le Quai d’Orsay avait voulu piquer d’honneur l’Angleterre, la pousser à tenir bon contre le refus américain déjà certain. Nous avons déjà dit que nous tenions ces propos pour extravagants[14].
Bizarrement, Le Populaire est le seul journal de toute la presse française[15] à faire écho à ces « bruits étranges ». Aucun autre en effet, dans un premier temps, n’a repris l’idée, fût-ce pour, comme Blum, la contester. On le verra, les journaux seront bientôt obligés d’envisager comme plus que probable l’hypothèse d’une fuite volontaire, décidée au Ministère, pour des raisons à définir.
Éviter le pire
On comprend que le ministère des Affaires étrangères ait voulu éviter que l’affaire n’éclate et qu’il soit soupçonné d’être à l’origine de la fuite, surtout s’il ne s’agissait pas que d’un soupçon. Il a manifestement voulu faire baisser la pression quand il fait savoir que « l’accord intervenu ne comporte ni entente d’état-major, ni convention politique, ni clauses secrètes d’aucune sorte[16] ». Beaucoup de journaux le répètent. Titre de Cross : « Une révélation qui n’en est pas une[17] ».
De l’enquête qu’a menée le Ministère depuis la publication par Horan de la circulaire de Berthelot, rien de précis n’a d’abord transpiré dans la presse. On saura seulement plus tard qu’Horan, une première fois convoqué au Quai d’Orsay, reçu par Paul Bargeton, Chef du service de la presse[18], avait indiqué que c’est Hearst, son patron, that, en septembre, lors d’un de ses séjours à Paris, lui avait remis la circulaire de Berthelot pour que le texte en soit transmis à Londres, et de là à New York, en vue de sa publication. C’est également plus tard qu’on aura confirmation que Horan avait effectivement, dès ce moment été prié – et avait accepté – de quitter le pays[19].
On apprendra de même tardivement qu’au sortir du Ministère, Horan avait immédiatement informé son patron qu’il était menacé d’expulsion et que Hearst avait aussitôt envoyé un de ses collaborateurs à Washington pour rencontrer Kellogg, le Secrétaire d’État, et obtenir qu’une protestation officielle soit élevée contre la France. Il avait confirmé dans ses journaux les déclarations de son collaborateur selon lesquelles c’est bien lui, Hearst, qui lui avait remis le document.
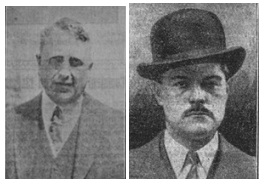 Premières photos de Hearst
Premières photos de Hearst
(à gauche, in Comoedia) et de Horan (à droite, in La Volonté), 10 th 1928.
Kellogg s’est borné à demander à son ambassadeur à Paris Myron T. Herrick, d’aller aux renseignements et de solliciter l’indulgence des autorités françaises pour Horan. De tout ceci, on n’a d’abord rien su. L’affaire apparemment pouvait encore ne pas éclater.
Qui à Paris a décidé de se satisfaire des réponses de Horan et obtenu de lui qu’il quitte volontairement la France, quietly, sans arrêté d’expulsion ?
Étonnante cette décision qui revient à se priver de la possibilité de l’interroger de nouveau, pour les besoins de l’enquête. Berthelot pour sa part aurait souhaité qu’il reste à la disposition des enquêteurs, ce n’est pas son avis qui a prévalu auprès de Briand. Est-il sûr qu’alors, on souhaitait vraiment qu’elle aboutisse ?
Un fait semble confirmer que le Ministère ne souhaitait pas qu’on s’intéressât trop à l’origine de la fuite : il a banalisé le document en le faisant publier, the 5 th 1928, dans la presse amie, en l’occurrence L’Écho de Paris. Le texte sera intégralement reproduit dans la plupart des autres journaux à partir du lendemain. L’idée serait que plus il sera connu, moins sa fuite éventuelle sera grave et moins on cherchera à en identifier le responsable.
Dans le même but, le Ministère n’a pas non plus fait savoir qu’Horan a été une dernière fois convoqué, Saturday 6 th 1928, au motif qu’il n’avait pas encore quitté le pays comme il s’y était engagé[20]. Y a-t-il à nouveau été interrogé sur ses contacts au Ministère ? Les noms de possibles complices ont-ils alors été prononcés ? La presse jamais n’en dira rien. L’a-t-on alors averti de l’imminence de son interpellation et des risques qu’il encourait s’il demeurait plus longtemps ? C’est possible mais on n’en a rien su. Pas plus qu’on ne saura qui l’a reçu.
Les journaux n’en disent mot. Berthelot, Army ?. Il est sûr que l’un, en sa qualité de Secrétaire général du Ministère, comme l’autre, Chef du Cabinet de Briand, eurent connaissance de cette affaire et que rien ne fut décidé sans eux[21].
Au Quai d’Orsay, Saturday 6 th, on a apparemment voulu donner à Horan une dernière chance de disparaître. Et se donner une dernière chance que l’affaire n’éclate pas.
S’il avait quitté immédiatement le territoire, l’affaire aurait pu ne pas éclater puisque personne en France n’aurait plus été en mesure de l’interroger de nouveau et le risque qu’il complète ses premières déclarations et révèle le nom du ou des personnes qui avaient remis le document à Hearst était écarté. Or, deux jours après sa dernière convocation au ministère des Affaires étrangères, Horan n’ayant pas encore quitté le territoire, la police est intervenue, le lundi 8 th, l’a « arrêté » (le terme sera contesté), en pleine rue, puis longuement interrogé. L’information est dès le lendemain dans de nombreux journaux, en France et dans le monde, particulièrement aux États-Unis, puis dans toute la presse. L’enquête sur l’affaire était administrative, et discrète, elle devient policière et éclate au grand jour.
Dramatic Scene in Rue de la Paix[22] - 1976 Interpellation de Horan (8 th 1928)
Le lundi 8 th 1928, at 13 p. m., en pleine rue, Horan a été contraint de se rendre à la Préfecture de police, quai des Orfèvres, et y a été retenu pendant sept heures[23].
Ses collègues de l’International News Service, prévenus par l’un d’entre eux qui avait assisté à la scène, inquiets de son sort, se présentèrent au Quai d’Orsay, supposant que le Ministère pouvait ne pas être étranger à l’affaire. La presse, y compris aux États-Unis, en témoignera :
Alors que la rumeur de l’arrestation d’Horan se répandait, les journalistes ont interrogé les sources les plus élevées du ministère des Affaires étrangères, sans succès. Tous les fonctionnaires ont exprimé une entière surprise[24].
Le Quai d’Orsay a nié savoir quoi que ce soit sur l’affaire[25].
William Bird, le Président du Comité de la presse anglo-américaine, ne voyant pas Horan venir à leur rendez-vous – les deux hommes devaient déjeuner ensemble –, et averti par ses collègues de l’International News Service, se rendit lui aussi au Ministère « pour protester contre la mesure dont M. Harold Horan avait été l’objet ». À lui, on n’a pas osé mentir mais on a minimisé les faits, « il [him] fut répondu que M. Horan n’avait pas été arrêté, mais simplement interrogé[26] ». Quand il communiquera officiellement sur l’affaire, le Ministère affirmera de même que « M. Harold Horan a été très courtoisement appréhendé rue de la Paix par des policiers[27] ».
Peu après vingt heures, à sa sortie de la Préfecture de police, Horan se rendit à son agence et fit à ses collègues un récit détaillé de ce qui lui était arrivé. C’est ce qui explique que dès le lendemain matin, on Tuesday 9, les deux journaux américains de Paris, l’International Herald Tribune et le Chicago Tribune, appartenant tous deux au même groupe de presse que l’agence International News Service, aient été en mesure de publier son récit.
L’International Herald Tribune évoquera « un hold up spectaculaire » (« a spectacular hold up[28] ». Le décalage horaire aidant, l’information est donnée ce même jour dans de nombreux journaux américains qui en rajouteront un peu en matière de sensationnel avec « coup de sifflet strident d’un policier » (« shrill whistle of a policeman ») et intervention d’au moins cinq policiers et d’un « officier en civil accompagné d’adjoints » (« officer in plain clothes accompanied by aides »), sous les yeux une « foule énorme » (« tremendous crowd »), d’où des titres tels que « Une scène d’enlèvement de Far-West rue de la Paix » (« A Far-West Kidnapping Scene on the Rue de la Paix »), « Sept heures au secret » (« Seven Hours Incommunicado »), « Le retour de l’Inquisition » (« The Return of the Inquisition[29] »).
In 1985, le journaliste J. C. MacDonald publiera ses souvenirs de la scène dont il fut témoin avec « des centaines de personnes » (« hundreds of persons had witnessed the arrest »). Arrivée du commissaire : « Dans des hurlements de freins, une grande limousine a aussi surgi et plusieurs agents excités de la Sûreté Générale (Services secrets) en ont sauté » (« With screeching brakes a large limousine drew up also, and out hopped several excited agents of the Surete General (Secret Service)[30] »).
Le mardi 9 th 1928, les journaux français ont eux aussi évoqué plus ou moins longuement les événements de la veille, à Paris comme en province Le Phare de la Loire, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, La Gazette de Biarritz-Bayonne and Le Petit Marseillais. À partir du mercredi 10 th, tous les journaux parisiens en parleront, immédiatement relayés par tous les titres de province et cela quotidiennement, pendant une dizaine de jours, from L’Écho d’Alger at L’Avenir du Tonkin et à l’étranger, from June New York Times to Guardian de Londres et jusqu’aux journaux d’Ottawa et de Sidney.
Outre les deux journaux américains de Paris, un quotidien français du matin a joué un rôle important dans l’affaire, L’Écho de Paris, déjà plusieurs fois nommé. Il se trouve en effet qu’à la sortie de la Préfecture de police, Horan, avant même d’aller retrouver ses collègues, a rencontré un collaborateur de ce journal, Jean-Gabriel Lemoine, si bien que celui-ci pourra, seul de tous ses confrères et concurrents français, faire des événements un récit circonstancié et reproduire les propos de Horan.
Le récit de Lemoine, paru dès le mardi 9 th 1928 in the morning, en même temps que les deux quotidiens américains de Paris, contraste avec les autres journaux français qui d’abord se bornent à mentionner l’incident en quelques lignes. Les journaux du soir, dont les collaborateurs avaient découvert l’affaire dans L’Écho de Paris, en furent réduits, faute d’informations, à seulement reproduire l’article de Lemoine ou à le paraphraser, le temps que leurs propres enquêtes leur permettent d’en dire davantage.
Il se peut que Lemoine se soit trouvé par hasard au bon moment au bon endroit mais il est possible aussi qu’il ait bénéficié d’informations privilégiées, le Directeur de son journal, Pertinax, étant, parmi les journalistes, un des plus proches d’Alexis Leger.
D’un journal à l’autre, les textes varient seulement sur des détails. Certains disent qu’Horan a été intercepté alors qu’il était dans un taxi, other, les plus nombreux, qu’il conduisait son propre véhicule, qu’un homme est monté à son côté et qu’Horan est resté au volant jusqu’à la Préfecture de police. Le nom de cet homme, Faux-Pas-Bidet, un commissaire affecté à la Sûreté nationale, sera révélé plus tard.
Horan défendu par ses pairs
Sommé d’indiquer sa source, Horan a d’abord refusé, comme est censé le faire tout journaliste, et comme il l’avait fait quand il avait été convoqué au Quai d’Orsay. Il a alors seulement répété que c’était bien lui qui avait fait parvenir le document aux États-Unis et que celui-ci lui avait été remis à la mi-septembre par son patron, Randolph Hearst, de passage à Paris. Les policiers, malgré leurs efforts, n’auraient pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit d’autre. Ils l’ont en effet menacé du pire s’il n’obtempérait pas, il allait être incarcéré à la Santé, le temps qu’un Juge d’instruction soit nommé, que celui-ci mène une enquête préliminaire, qui prendrait un temps certain et immanquablement déboucherait sur un procès avec six ans de prison à la clef. En vain. C’est du moins ce qu’on lira dans la presse.
Après avoir signé sa déposition, Horan fut autorisé à quitter librement la Préfecture de police, à la condition de s’engager à quitter, spontanément là encore (?), le territoire dans les deux jours. C’est ni plus ni moins ce qui avait été décidé au Quai d’Orsay.
On lui aurait refusé de contacter un avocat (pourquoi un avocat dira-t-on puisqu’officiellement il n’était pas arrêté) ni quiconque à l’extérieur, par exemple ses confrères de l’International News Service. Il n’avait pas déjeuné et c’est tout juste si on l’a autorisé à se faire apporter un sandwich au jambon et une bière. On le verra, d’autres seront moins bien traités.
Mais tout ceci n’est que ce que la presse en dira d’abord, sur la foi des déclarations de l’intéressé.
La presse ne rendit pas compte immédiatement du résultat de la rencontre, à Washington, du représentant de Hearst avec le Secrétaire, Frank Billings Kellogg. Hearst fut apparemment prévenu que le Secrétaire d’État n’avait pas voulu prendre l’initiative d’une protestation. Aussi Hearst, le lendemain, on Tuesday 9 th, viendra-t-il en personne à Washington pour être reçu par le Président Calvin Coolidge dans le même but. L’arrestation d’un citoyen américain, d’un journaliste qui plus est, était une première et avait de quoi faire réagir les plus hautes autorités du pays[31].
Hélas pour Hearst, Coolidge, pas plus que Kellogg, n’avait manifestement pas l’intention de provoquer un incident diplomatique, si peu de jours après la signature à Paris du pacte Briand-Kellog. Dès le premier jour, avant même d’avoir reçu Hearst, il avait déclaré :
L’affaire du journaliste américain Horan ne peut concerner que le gouvernement français et elle ne justifie pas une intervention du gouvernement de Washington ; celui-ci désire cependant protéger les citoyens américains[32].
Alors seulement la presse rendit compte de la réponse de Kellogg au représentant de Hearst en ces termes :
Réglant son attitude sur l’avis donné par le Président Coolidge, le département d’État ne donnera pas suite à la requête de M. Hearst qui a fait une démarche pour réclamer une enquête officielle des autorités américaines[33].
Le Secrétaire d’État a seulement demandé à son ambassadeur en France, de se rendre au Quai d’Orsay pour obtenir des explications.
Quant au Président Coolidge, recevant Hearst lui-même, il lui aurait déclaré :
Je crois que l’arrestation de Horan est une affaire domestique de la France et que les États-Unis ne peuvent rien faire. Dans cette circonstance, la France a agi dans la limite de ses droits[34].
In Paris, c’est Norman Armour, le chargé d’affaires américain qui, au nom de l’ambassadeur, a effectué la démarche voulue par Kellogg. Il fut reçu au Ministère dès le mardi 9 th 1928 après-midi, par le Directeur des Affaires politiques et commerciales, Charles Corbin. Celui-ci lui aurait donné tous les détails sur l’interrogatoire subi par le journaliste et susceptibles de le rassurer, notamment que celui-ci « n’a pas été arrêté, [qu’] il n’a été que soumis à un interrogatoire et [qu’] il a consenti de lui-même à quitter la France avant jeudi[35] ». Dans The Work, il sera bien précisé qu’Armour était « venu seulement aux renseignements [et qu’il] n’a fait aucune représentation au Quai d’Orsay[36] ». Toujours informé à bonne source, L’Écho de Paris confirmera qu’Armour « n’a pas protesté contre la sanction prise à l’égard de M. Horan, il a simplement demandé [que l’ambassade soit] tenue au courant des faits » et sollicité, comme on le lui avait demandé, l’indulgence des autorités françaises pour Horan.
Ce même mardi 9 th 1928 après-midi, William Bird, le Président du Comité de la presse anglo-américaine, réunit les membres de son organisation et ensemble, à l’unanimité, ils décidèrent d’adresser à Poincaré, Chairman of the Board, et à Briand, Ministre des Affaires étrangères, l’un et l’autre absents de Paris, deux télégrammes pour protester contre la décision d’expulser Horan et demander qu’elle soit rapportée, pour demander aussi un complément d’enquête et pour rappeler les autorités françaises au respect des droits de la presse, notamment du droit, pour un journaliste, de ne pas révéler ses sources.
Bird se présenta au Ministère le jour suivant, mercredi 10 th 1928 après-midi, avec plusieurs membres de son organisation, pour y déposer officiellement son télégramme à Briand. Ils y furent reçus par le Secrétaire général, Berthelot, that, après en avoir pris connaissance, affirma à ses interlocuteurs que la situation de Horan n’était pas encore définitivement arrêtée et que pour l’heure, il avait été décidé de l’autoriser à demeurer en France jusqu’à la fin d’une nouvelle enquête. Aussi bien, c’est ce que personnellement Berthelot souhaitait depuis le début.
Berthelot dit aussi – et autorisa Bird à le répéter – « ses regrets de la façon un peu cavalière avec laquelle le journaliste américain a été conduit lundi à la Préfecture[37] ». Bird sortit pleinement satisfait du Quai d’Orsay et le fit savoir aussitôt dans un communiqué. Il adoptait la même attitude que son gouvernement :
Puisqu’on ne demandait plus à Horan de quitter le pays, qu’au contraire on lui demandait désormais d’y demeurer, la Préfecture de police a alors cherché à l’avertir mais ne sut l’atteindre. Elle alerta la police des frontières pour l’intercepter s’il s’y présentait. On apprit plus tard, Friday, May 12 th, qu’il avait quitté Paris pour Bruxelles dès le mercredi 10 à midi, qu’il avait depuis été vu à Anvers, à moins que ce ne fût Ostende, puis à Londres, et qu’aux dernières nouvelles, il voguait vers les États-Unis.
In France, à l’étranger, des voix s’étaient élevées contre la décision d’expulser Horan mais sans faire les gros titres de la presse. Le syndicat de la presse socialiste éleva une protestation[38] mais aussi plusieurs journaux comme La Liberté, Paris-Midi and The Uncompromising, d’où ce titre à peine exagéré du Chicago Tribune : « Parisian Press Defends Horan[39] ». En Allemagne, the Berliner Tageblatt affirme que « Tous les journaux devraient protester contre une telle atteinte à la liberté de la presse[40] » et ajoute qu’on « ne peut croire que la police [ait] agi d’accord avec le ministère français des Affaires étrangères ».
Une information de première importance va bientôt faire entrer l’affaire dans une nouvelle phase.
Horan a nommé ses informateurs
Poincaré, depuis sa résidence de Sampigny, avait immédiatement répondu au télégramme de Bird et des journalistes américains pour affirmer que l’affaire relevait du Quai d’Orsay. Briand, depuis sa résidence de Cocherel, dans la soirée du mercredi 10, fit savoir qu’il avait « chargé Léger de voir le comité de la presse anglo-américaine[41] ». Il est de plus en plus évident que c’est lui, Army, plus que tout autre qui suit de plus près cette affaire.
Bird et ses collègues furent donc finalement reçus par Leger dès le lendemain, Thursday 11 th 1928 in the morning, from 10 . 30 at 12 . 15 et le moins qu’on puisse dire est qu’effectivement l’affaire était en train de prendre une autre tournure. À l’issue de la réunion, le Quai d’Orsay dans un communiqué affirmera que les explications données aux journalistes les ont pleinement satisfaits[42]. Aucun journal n’a démenti.
La délégation s’est déclarée satisfaite des explications qui lui ont été fournies. Elle a prié M. Alexis Léger de remercier M. le Ministre des Affaires étrangères d’avoir bien voulu lui donner l’occasion de s’acquitter, dans le plus bref délai, du mandat qu’elle avait reçu.
Certains journaux ont laissé entendre que le communiqué avait été rédigé en commun par Leger et les journalistes.
Que leur a donc dit Leger pour qu’il obtienne ce beau résultat ? Morning en rend compte le lendemain, Friday 12 :
[Army] leur donna connaissance des déclarations faites par M. Horan lors de son interrogatoire à la Préfecture de police. Non seulement le représentant de M. Hearst avait avoué qu’il s’était procuré le document par des moyens illicites, mais encore il avait donné des indications précises sur les personnes dont il s’était assuré le concours[43].
Personne ne le savait alors mais ces personnes dont Horan avait donné les noms le lundi, lors de son interrogatoire, avaient été longuement interrogées à la Préfecture de police pendant toute la journée du mercredi 10 et auraient avoué leur implication dans la fuite du document. Leger en avait aussitôt été averti d’où les révélations qu’il fit aux journalistes américains le jeudi 11 in the morning.
Ceux-ci, après avoir entendu Leger, en tirèrent immédiatement les conséquences : ils exclurent Horan de leur organisation pour faute professionnelle et pour leur avoir menti. Toute la presse s’en fit l’écho.
Leger avait-il précisé le nom du ou des informateurs de Horan au cours de son entretien avec les journalistes américains ? Peut-être, peut-être pas. S’il l’a fait, ses interlocuteurs ne divulguèrent pas immédiatement ce qu’ils avaient appris de Leger, sans doute à sa demande.
L’identité des suspects a officiellement été communiquée à l’ensemble des journalistes accrédités au Quai d’Orsay le lendemain matin, Friday 12 th 1928. L’information sera donnée le jour même dans un journal de province, La Gazette de Bayonne-Biarritz et Saint-Jean-de-Luz[44], les journaux de Paris ne la donneront que le lendemain, de même la plupart des autres journaux de province.
Ce vendredi 12 th, en recevant les journalistes, Paul Bargeton a donné les noms des personnes incriminées pour « remettre l’affaire dans ses limites véritables et faire justice de certaines informations fantaisistes ».
Il [Bargeton] a tenu à affirmer que seules trois personnes étaient mêlées à cette affaire : Mrs. Harold Horan, qui est en fuite, Mrs. Roger Deleplanque et M. de Noblet[45], qui appartient au bureau de la presse du Quai d’Orsay[46].
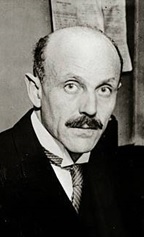 Paul Bargeton, Chef du service de la presse au Quai d’Orsay.
Paul Bargeton, Chef du service de la presse au Quai d’Orsay.
Depuis le mercredi 10 th, des rumeurs plus ou moins explicites et contradictoires étaient apparues dans plusieurs journaux, toutes en même temps, quant à l’identification d’au moins un suspect. Origine probable de ces rumeurs : des bouts de confidences faites à des journalistes par des policiers proches de l’enquête en cours.
Il semble que dans plusieurs rédactions, on savait déjà ce qu’il en était. Sans donner aucun nom, on évoquait deux suspects, un journaliste et un fonctionnaire du Quai d’Orsay, L’Écho de Paris comme d’autres expliquant que si l’on n’était pas plus précis, c’était que « l’enquête n’a[vait] pas encore achevé de déterminer la responsabilité exacte du jeune Secrétaire d’ambassade[47] ».
Selon Le Petit Journal, « le bruit courait [dès le jeudi 11] qu’une première arrestation avait été effectuée[48] ». Son presque homonyme, Le Journal, croit savoir qu’il s’agit « d’un de ces hommes qui mettent parfois leurs relations mondaines au service de la police et qui évoluent en marge à la fois de la diplomatie et des affaires[49] ». Le Petit Journal évoque un policier en poste au Quai d’Orsay. Selon Centre-Ouest, il pourrait s’agir de la même personne, « un quasi-diplomate et policier mondain dont tout le monde sait le nom[50] ». Morning, Le Gaulois et d’autres parlent de deux arrestations. Toutes ces rumeurs s’avèreront fausses.
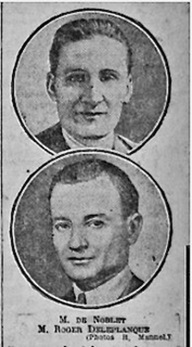 Le Journal, Sunday 14 th 1928
Le Journal, Sunday 14 th 1928
Premières photos de Noblet (en haut) et Deleplanque (en bas) dans la presse française.
Autres photos dans Le Petit Journal du même jour.
Le Préfet de police se crut obligé, Friday, May 12, de préciser qu’« aucune arrestation concernant un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères n’a été opérée ni envisagée[51] ». Pourquoi cette précision sinon parce que la rumeur en circulait ?
Le Petit Parisien le répète[52] :
La révélation par Bargeton du nom des suspects n’a pas fait immédiatement cesser les rumeurs. Dimanche 14, le journal Le Peuple évoque non pas trois mais cinq ou six suspects : en plus de Horan, d’un journaliste et d’un Secrétaire d’ambassade, « il est fortement question d’autres personnes[53] », d’un autre journaliste, d’une dactylographe et d’un autre complice assez mystérieux, ce qui laissse espérer de nouveaux rebondissements.
Certains journaux, en France, vont incriminer une femme, la maîtresse de Hearst, Marion Davies, une actrice de cinéma dont Hearst veut faire une star. Ils donnent les dates et les circonstances où le document aurait été remis à celle-ci puis par elle transmis à Hearst. The 15 September[54]. Le scoop fait long feu.
Aux États-Unis, et aux États-Unis seulement, les journaux ont identifié une autre femme, non une actrice de cinéma mais une romancière et dramaturge, dont les pièces connaissent alors un certain succès tant à Londres qu’à Paris, une danoise du nom de Karen Bremson (en France, on l’appelle plutôt Bramson). Elle avait à Paris, répète-t-on partout, un bon ami haut placé au Ministère… Le nom de ce dernier n’est nulle part précisé, et aucun journal français n’a repris l’information. Faute de la connaître ? Par prudence plutôt, spontanément, ou à la suite d’une consigne reçue. Cet ami haut placé au Ministère aurait alors tout de suite été identifié : Alexis Leger. Il nous a fallu attendre l’année 2000 pour qu’Holger Holst nous révèle l’étroite liaison qui a existé entre elle et Alexis Leger avant qu’il ne parte pour la Chine[55].
On trouve seulement une possible allusion discrète à Karen Bramson, à moins qu’il ne s’agisse de Marion Davies, à la fin d’un article du Petit Parisien :
Terminons enfin en déclarant que contrairement à tous les bruits qui ont couru, et dont certains journaux se sont faits l’écho, aucune autre personne – homme ou femme – n’est compromise dans cette regrettable affaire[56].
La principale rumeur, que l’identification des auteurs de la fuite est censée arrêter, c’est celle, très ancienne et récurrente, selon laquelle cette fuite aurait été voulue par le Ministère lui-même. Dans ces conditions, les deux suspects, le journaliste et surtout, le Secrétaire d’ambassade, Deleplanque et Noblet, ne seraient que des boucs émissaires ? Cette hypothèse, au fil du temps, on le verra, n’est pas gratuite.
« Les fuites du Quai d’Orsay », tel est le titre de l’article consacré à l’affaire ce même vendredi 12 th 1928 in L’Ami du Peuple, repris par Le Petit Journal. Dans Le Gaulois, on suggère que cette fuite, qui pourrait bien être accidentelle, ne serait pas la première :
Le document a-t-il été volé ? Toute la presse l’a d’abord envisagé. A-t-il été acheté ? Nombre de journaux ont défendu cette autre hypothèse, précisant les sommes que Hearst avait mises à la disposition de Horan pour rétribuer ses complices, Deleplanque, le journaliste, Noblet, le fonctionnaire du Quai d’Orsay. Rien n’a pu être prouvé.
Le Ministère a dès le début fait entendre que, s’agissant de Noblet, « l’hypothèse d’un acte de légèreté [is] la plus plausible[57] » et la plupart des journaux l’ont répété à satiété.
On ne croit pas que M. de Noblet se soit laissé corrompre[58].
Il n’y a pas eu de corruption de fonctionnaire mais une simple imprudence d’un jeune diplomate[59].
Le fonctionnaire a cédé à une insistance de bon aloi dont rien ne lui permettait de croire qu’elle était stipendiée[60].
Pas de corruption de fonctionnaire mais une simple faute professionnelle[61].
Mrs. de Noblet, l’attaché du service de presse et d’information du Quai d’Orsay, dont la bonne foi a été surprise, n'[is] passible que de sanctions administratives[62].
Il avait cru bien faire, le document ne révélait rien qui ne fût connu et n’était pas estampillé « secret ». Pourquoi aussi le document avait-il été envoyé au service de presse sinon pour qu’on s’en serve ?
Autre argument en faveur de Noblet :
Disons-le tout de suite, ce fonctionnaire appartient à une excellente famille et son honorabilité apparaît au-dessus de tout soupçon[63].
Et puis il est si jeune (trente ans)…
Apparemment, même si l’affaire devait être confiée à la justice, Noblet n’aurait pas grand-chose à craindre.
Conseil des ministres (16 th 1928)
Elle le sera. Briand, revenu à Paris le lundi 15 th, après s’être longuement entretenu avec Leger, en a décidé ainsi. Il présentera les résultats convergents des deux enquêtes, administratrive et policière, qui l’une et l’autre incriminent Deleplanque et Noblet, et obtiendra du Conseil que l’affaire soit transmise à la justice, à charge pour le Parquet de s’en saisir ou non. Indeed, le Parquet ouvrira une enquête préliminaire et un Juge d’instruction sera nommé, un certain Girard.
Difficile d’éviter que la Justice soit saisie, trop de journaux en effet rappellent qu’il s’agit en l’occurrence de rien de moins que d’une affaire d’espionnage et rappellent, textes à l’appui, les peines encourues si le Juge pense les charges suffisantes pour qu’on aille à un procès, et ces peines sont énormes.
Titres de L’Ouest-Éclair and L’Écho de Paris from June 25 th 1928 :
Certains journaux, moins avides de sensationnel, plus prudents ou mieux informés, sensibles à l’insistance avec laquelle le Quai d’Orsay a, dans ses divers communiqués, systématiquement minimisé la responsabilité du fonctionnaire, avancent l’idée que Noblet au moins pourrait bénéficier d’un non-lieu. Au lendemain du Conseil des ministres, avant même que la Justice se soit saisie de l’affaire, The Work l’avait dit on ne peut plus clairement :
Une circulaire destinée à 40 postes diplomatiques français à l’étranger et aux principaux services intérieurs du ministère des Affaires étrangères est-elle un document intéressant la défense nationale ?
On peut tout plaider, mais c’est sujet à dispute.
À notre avis, si une instruction judiciaire est ouverte, elle sera close par un non-lieu[64].
Chaque élément nouveau de l’enquête judiciaire va déclencher une vague d’articles avec rappels des faits, résultats des perquisitions, déclarations de l’avocat de Deleplanque, de l’intéressé lui-même, interrogatoire de Deleplanque (dans la presse le 31 th 1928), déposition de Charles Corbin devant le Juge, confrontation entre les deux inculpés, déposition de Noblet (the 3 November). Le principe du secret des instructions est allègrement bafoué par tous.
L’enquête progressant à son rythme, l’affaire ne fera donc plus les titres des journaux que de loin en loin, après des pauses de plusieurs mois quelquefois. Quand l’actualité judiciaire amène les journaux à en reparler, ils se croient obligés de rappeler en quoi elle consiste, signe que le grand public a tendance à l’oublier.
S’il est enfin question de l’enquête le 31 March 1929, in La Dépêche, c’est pour annoncer que l’affaire va déboucher bientôt sur un non-lieu :
En fait la décision ne sera prise que cinq mois plus tard, the 20 août 1929. Deleplanque et Noblet, l’un et l’autre, bénéficieront effectivement d’un non-lieu.
Noblet interprétera cette décision comme une reconnaissance de son innocence, elle signifie pourtant seulement que le Juge d’instruction n’a pas réuni de preuves suffisantes pour charger un suspect. Le Parquet aurait donc pu faire appel de la décision (le ou les responsables de la fuite du document n’ont en effet pas encore été identifiés). Le Parquet ne fera pas appel.
L’affaire est donc ou semble close. Une bonne partie de la presse le répète et approuve, et ceci aux quatre coins du monde. Titre de The Chicago Tribune the 21 août : « Horan Affair’ Ends in Exoneration of Two Accused Aides[65] ». Titre de L’Avenir du Tonkin the 22 : « Un non-lieu clôt l’affaire de soustraction de document du Quai d’Orsay ».
Ce qui a amené le Juge à prononcer un non-lieu est notamment le fait que le document secret avait été ronéoté à cinquante exemplaires et que celui que Noblet avait dans son coffre y a été retrouvé avant son retour au Ministère : étant en vacances depuis le jour où Deleplanque dit le lui avoir emprunté, Noblet n’a pas pu l’y replacer lui-même. Horan l’avait-il recopié sur place ? Certains l’ont envisagé. Il a certes été établi que Noblet a quitté un moment son bureau, Saturday 15 September 1928, between 18 and 19 p. m. 30, et qu’il y a laissé un moment Deleplanque seul. Mais en si peu de temps, Horan n’a pas eu la possibilité de recopier, à la main, le document et ses onze feuillets[66].
Lors de leur confrontation devant le Juge, Deleplanque et Noblet ont fait des déclarations divergentes sur des points essentiels, le premier a chargé le second, celui-ci a nié, ce fut parole contre parole et le Juge n’en put tirer aucune conclusion, d’où les non-lieux.
Retour sur le rôle de Leger
Le Ministère, dans un long communiqué, fait l’historique complet de l’affaire et la considère comme close[67]. Il est suivi par une bonne partie de la presse mais non toute.
L’Action française en effet, and Le Figaro, jour après jour, de même l’hebdomadaire Aux Écoutes, répètent à l’envi que le ou les responsables de la fuite, fût-elle accidentelle, n’ont toujours pas été identifiés et émettent des réserves sur les conditions dans lesquelles Deleplanque et Noblet ont, paraît-il, signé leurs aveux.
À ce stade, un seul fait est établi : il est clair qu’il n’y aura pas d’accord franco-britannique. Les négociations sur le désarmement naval à terme vont donc pouvoir reprendre mais sur des bases nouvelles, collectives, conformes à l’esprit de Locarno, dans la continuité du pacte Briand-Kellog. À la plus grande satisfaction de Leger et Briand. Une fois déjà, in 1927, après un blocage des négociations, au moment où Briand avait reçu des assurances quant à leur reprise, il s’était exclamé : « Locarno continue[68] ». Il pourrait le dire à nouveau.
Que l’échec du compromis franco-britannique puisse réjouir Briand et Leger ne signifie pas forcément qu’ils l’aient provoqué. Le rôle de Leger dans l’affaire n’a donc pas encore été prouvé. Déduit jusqu’ici de multiples indices, il apparaît tout au plus comme possible, voire vraisemblable, mais des indices, même nombreux, même convergents, ne sont pas des preuves. L’Action française pour sa part a tendance à plus impliquer Berthelot, le Secrétaire général du Ministère, que le Chef du Cabinet du Ministre. Les contemporains au mieux peuvent soupçonner tel ou tel mais la presse ne leur permet pas d’aller au-delà.
Aujourd’hui, en prenant le temps de bien lire les journaux, tous les journaux, nous le pouvons. Dans la dernière période, un certain nombre d’informations ont été données dans la presse qui n’ont pas été vues, tant elles sont espacées les uns des autres et semblent de peu d’ importance. Nous qui avons maintenant la possibilité de consulter facilement, sur des bases de données[69], des millions de pages dans des milliers de journaux, et disposons de moteurs de recherche de plus en plus efficaces, nous pouvons débusquer là où elles se cachent ces informations demeurées inaperçues jusqu’ici. On va le voir, certaines constituent comme le maillon qui manquait à l’enchaînement des faits reliant Leger à l’affaire.
Deux informations décisives, données par quelques journaux seulement et sans aucun signe de leur importance, ont ainsi été repérées.
D’abord et surtout la mention d’un aller-retour express de Leger à Cocherel pour rencontrer Briand chez lui, Wednesday, 10 th. Autre mention importante, celle de la venue d’Édouard Renard, le Directeur de la Sûreté générale, au ministère des Affaires étrangères, le lendemain, Thursday 11 th, spécialement « pour conférer avec Leger[70] ». Ce sont des détails dont quelques journaux seulement font mention, en une ou deux lignes…
Les deux rencontres ne confirment pas seulement le rôle joué par Leger dans l’affaire, elles attestent, quand on les replace dans leur contexte, et sans doute possible, le caractère essentiel de son rôle dans les prises de décisions et leur mise en œuvre.
Leger à Cocherel (10 th 1928)
Leger a en effet effectué un aller-retour express de Paris à Cocherel, dans l’Eure, at 83 kilomètres de Paris, pour rencontrer Briand, Wednesday, 10 octobre en fin d’après-midi.
Seule précision donnée par Le Journal des Débats : les deux hommes ont eu « une longue conversation » après quoi Leger « est rentré à Paris avec des instructions précises[71] ». C’est justement le mercredi 10 au soir, alors que Leger était encore à Cocherel, Briand fit savoir qu’il avait « chargé Léger de voir le comité de la presse anglo-américaine[72] ».
 Les Hulottes, résidence de Briand à Houlbec-Cocherel
Les Hulottes, résidence de Briand à Houlbec-Cocherel
C’est à cette occasion que Briand semble avoir découvert l’affaire. Apparemment, Leger lui a alors présenté pour la première fois le dossier qu’il avait constitué et déjà remis à la Police. Jusque-là, ils en avaient tout au plus parlé au téléphone. Plusieurs journaux insistent soudain trop systématiquement, et dans les mêmes termes, sur le fait que Briand avait suivi l’affaire attentivement jusqu’ici pour ne pas faire penser que l’idée leur a été soufflée. La presse américaine de Paris, en l’occurrence l’International Herald Tribune[73], est sans doute plus proche de la vérité quand elle signale qu’à la suite de la visite de Leger, Briand « allait veiller personnellement à la conduite de cette enquête » (« He will personaly see to the conduct of this enquiry »). Il allait le faire, il ne l’avait donc pas fait auparavant ?
Dans quelles circonstances ce départ de Leger pour Cocherel le mercredi 10 th ? Au matin de ce jour, Noblet, rappelé à Paris (il était en congé dans sa famille à Gaillac depuis la mi-septembre), s’était présenté au Ministère et avait été prié de se rendre au plus vite à la Préfecture de Police pour contribuer à l’enquête. Arrivé sur place à 14 p. m., il allait y être retenu jusqu’à 4 heures le lendemain matin, interrogé sans ménagement par trois inspecteurs successifs. Le dossier accusant Noblet, rédigé par Leger, leur avait été transmis, les policiers savaient donc exactement ce qu’il fallait faire avouer à Noblet. Excelsior ne masque pas le fait que « les résultats de l’enquête administrative avaient servi de directives à l’action judiciaire[74] ».
Pourquoi cet aller-retour ? Army, qui avait jusque-là dirigé l’enquête administrative au sein du Ministère, avait besoin, d’une part, que les initiatives prises par lui depuis la fin septembre soient validées par son Ministre. Cela théoriquement pouvait certes attendre puisque le retour de Briand à Paris, pour cause de Conseil des ministres, était prochain (retour prévu le lundi 15, Conseil prévu le mardi 16 th).
Ce qui ne pouvait attendre en revanche, c’était la suite à donner immédiatement aux résultats de l’interrogatoire de Noblet, quels qu’ils soient. Leger est donc parti à Cocherel en fin d’après-midi, à un moment où Noblet était encore retenu à la Préfecture de Police, sans savoir encore si les policiers parviendraient à leurs fins. Selon qu’ils y parviendraient ou pas, la suite à donner à l’affaire serait différente : Leger est allé au-devant de Briand pour envisager les deux options, selon ce que Noblet aura avoué ou pas.
Thursday 11 th, revenu à Paris, Leger a bien sûr été dès le matin informé des résultats de l’interrogatoire de Noblet (terminé à 4 heures du matin) : ce dernier aurait avoué son implication dans la fuite du document[75]. Le Chef de Cabinet de Briand pouvait donc sans délai mettre en œuvre le scénario prévu dans ce cas et à 10 p. m. 30, il recevait les journalistes américains pour faire état du résultat des enquêtes, à savoir l’identification de deux complices et leurs aveux. Ils avaient été dénoncés par Horan au cours de son propre interrogatoire le lundi 8. On l’a dit, Leger n’est peut-être pas allé jusqu’à dévoiler leur identité aux journalistes américains réunis autour de lui, on l’a dit aussi, elle ne sera communiquée à la presse que le lendemain matin, Friday 12 th, au Ministère, par Paul Bargeton, le Directeur du service de la presse.
Que ce soit Bargeton et non Leger qui donne l’information a dû comme le reste être prévu à Cocherel : le nom de Leger venait d’être donné dans la presse quand elle avait rendu compte de sa rencontre avec les journalistes américains, ceux-ci l’avaient nommément remercié pour les avoir reçus et éclairés sur l’affaire, mieux valait que son nom ne soit pas une fois de plus mentionné à cette occasion.
S’était posée à Leger et Briand, à Cocherel, la question de l’opportunité ou non, selon que Noblet aurait avoué ou non, de continuer à traiter l’affaire sur le seul plan administratif, comme une affaire interne au Ministère, ou au contraire de saisir la Justice. Briand et Leger ont choisi cette seconde option, pensant sans doute que les aveux de Noblet permettaient que l’affaire soit bientôt considérée comme pleinement élucidée et donc à terme déclarée close. Sans ces aveux, c’était impossible[76].
On ignore ce que Briand et Leger auraient fait si Noblet n’avait pas avoué. L’omniprésence de l’affaire dans la presse les aurait vraisemblablement contraints de prendre la même décision, simplement la suite se serait alors moins bien présentée pour eux.
Leur décision, prise dans de telles conditions, marque un tournant majeur de l’affaire. Les noms de Deleplanque et Noblet sont dans tous les journaux le lendemain, de même la confirmation que l’affaire serait abordée en Conseil des ministres le mardi 16, présentée par Briand, et qu’on y déciderait de la transmettre ou non au Ministre de la Justice. Tel était en effet le scénario qu’ils avaient imaginé à Cocherel au cas où les aveux de Noblet seraient conformes à leur attente.
Quelques journaux seulement ont fait état de cette rencontre à Cocherel et qu’il y avait été question « [d]es résultats de l’enquête administrative relative à l’affaire Horan[77]» dont « le dossier doit être soutenu [le lendemain] au Conseil des ministres[78] ».
Renard, Directeur de la Sûreté générale, reçu par Leger au Ministère (11 th 1928)
Mrs. Léger a longuement conféré avec M. Renard, Directeur de la Sûreté générale. Il semble que les recherches soient maintenant sur le point d’aboutir ; il y a lieu de croire que le ou les coupables, fonctionnaires ou journalistes assure-t-on, sont maintenant connus des autorités. Le Petit Provençal, Friday 12 th 1928.
 Édouard Renard, Directeur de la Sûreté générale
Édouard Renard, Directeur de la Sûreté générale
Comme si Leger l’ignorait ! Il en avait fait état devant les journalistes américains le matin même, mais l’information n’avait pas encore été publiée. Pourquoi ? Il importait à Leger et Briand qu’il apparaisse que c’était la Police qui avait confondu les deux coupables.
Présenter ainsi les choses tend en effet à faire croire à l’indépendance de la Police par rapport au Ministère alors qu’en réalité, la Police a agi en tout conformément aux desiderata de Leger, menant son enquête à partir du dossier que celui-ci avait constitué à charge contre Noblet. Non seulement cette indépendance apparente des deux enquêtes minimise pour l’opinion le rôle de Leger mais elle donne aussi plus de crédibilité à leurs conclusions (elles sont conformes).
Quelle qu’ait été la teneur de leur entretien, Leger a dû communiquer au Directeur de la Sûreté générale certains détails inconnus de ce dernier et dont il fallait l’informer pour éviter qu’il prenne une quelconque initiative susceptible de perturber le scénario prévu à Cocherel.
Leger a pu par exemple s’assurer que la Police se contenterait des aveux de Deleplanque et Noblet et ne pousserait pas plus loin ses investigations. Leger a reçu Renard le jeudi 11 en début d’après-midi, Bargeton le lendemain matin allait révéler à la presse les noms des coupables, il ne convenait pas que la Police en fasse douter. Renard a donné apparemment toutes assurances sur ce point (de fait, elle n’a pas poursuivi son enquête), aussi Bargeton a-t-il pu tenir sa conférence de presse.
Comme on a vu, dès le retour de Briand à Paris, le lundi 15 th, à la veille du Conseil des ministres[79], Leger a pu l’informer du fait que le scénario prévu pourrait donc être suivi sans risque et il l’a été.
Retour sur les aveux supposés de Noblet (10 th 1928)
Briand avait en mains le dossier de l’affaire qui n’est autre que celui qui avait été remis à la Police avant qu’elle n’interroge Noblet et que Leger avait montré à son Ministre à Cocherel[80] mais qu’il avait revu et enrichi des derniers développements de l’affaire, à savoir les aveux de Noblet.
Pour autant que les aveux de Noblet mettaient un terme à l’enquête, le mystère de la fuite du document était élucidé, personne d’autre ne serait inquiété… La presse a fait état de ces aveux, l’opinion y a cru.
On se trompait.
Ces aveux en effet ne sont pas avérés. S’agissant de Horan, un compte rendu de son interrogatoire du 8 th, à défaut d’un procès-verbal, avait été rédigé et partiellement publié, avec mention de ses aveux et dénonciation de Deleplanque et Noblet. On y découvre que Horan avant de parler avait reçu l’assurance que cela ne serait pas divulgué[81].
Mais s’agissant de Noblet, les lecteurs ne disposent de rien de tel. Ils n’ont connaissance ni d’un procès-verbal, ni d’un compte rendu, seulement de communiqués qui affirment sa culpabilité en même temps que divers indices en font douter. L’idée est émise ici ou là qu’un accord a été conclu entre Noblet et son Administration, qu’il aurait accepté d’être un temps présenté comme coupable de négligence ou d’imprudence contre la promesse qu’il serait très vite mis hors de cause et que sa carrière n’en souffrirait pas. De telles promesses n’ont pas vocation à être couchées par écrit.
Qu’est-ce qui peut faire penser que les choses se soient passées ainsi ? Le fait que ces promesses semblent avoir reçu un début d’exécution : Noblet et Deleplanque ont bénéficié d’un non-lieu après quelques mois d’instruction (dix mois tout de même), in August 1929. Il faut vraiment que Noblet ait eu le sentiment de servir le pays en acceptant le marché qui lui avait été présenté, et qu’il ait eu une pleine confiance dans sa hiérarchie, pour avoir supporté aussi longtemps sans réagir d’être dénoncé dans la presse.
Ce qui peut l’avoir poussé à patienter jusqu’au non-lieu et à croire que les promesses seraient tenues, – et à nous que promesses il y a eu – c’est qu’en de multiples occasions le Ministère qui avait porté plainte contre lui, relayé par la quasi-totalité de la presse, a minimisé son délit, parlant d’une simple faute administrative, d’une erreur de jeunesse commise par un fonctionnaire bien noté, issu d’une famille honorable, les Noblet d’Anglure. Cela est si patent que d’aucuns s’en sont étonnés, à l’extrême droite comme à l’extrême gauche. Manifestement « les hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay entendent absolument couvrir le noble M. de Noblet, menacé dans son avenir[82] ».
De son côté, loin de protester contre la plainte qui le vise, contre sa convocation devant un Juge d’instruction, contre les accusations proférées contre lui par la presse, Noblet n’a rien fait qui puisse empêcher que le scénario qu’on lui avait annoncé aille jusqu’à son terme, à savoir la proclamation de son innocence et sa réintégration. Le Petit Bleu de Paris en témoigne :
Mrs. de Noblet se refuse naturellement à toute interview et à toute déclaration[83].
Il en a reçu l’ordre[84] affirme Le Soir. Même sans ordre, Noblet suggère que spontanément il aurait fait de même :
À mon grand regret, nous a déclaré M. de Noblet, il m’est absolument impossible de vous faire la moindre déclaration sur cette affaire. Tout ce que je savais et qui me paraissait de nature à pouvoir faire éclater la vérité, je l’ai dit à mes chefs hiérarchiques. C’est à eux seuls qu’il appartient de faire les déclarations qu’ils jugeront opportunes et nécessaires. N’oubliez pas que je suis un fonctionnaire et, comme tel, astreint à la discrétion la plus grande.
Morning, on Tuesday 16 th 1928.
Noblet le répétera souvent en des termes où il manifeste, en fonctionnaire exemplaire, son entière soumission à ses chefs :
J’ai gardé le silence au début de cette affaire, ma situation de fonctionnaire m’obligeant à laisser à mon département le soin de donner des éclaircissements comme il le jugerait opportun[85].
Logiquement, rien ne s’oppose donc à ce que l’affaire soit bientôt déclarée close, et à terme oubliée pas l’opinion.
Seule menace, la vérité officielle n’est pas admise par tous. Une rumeur circule dont une certaine presse fait état, that, si elle était avérée, remettrait tout en question. Dès le 20 th Aux Écoutes écrit tout net :
Certains, the Quai d'Orsay, vont même jusqu’à affirmer que tout fut concerté entre M. Léger et une personne étrangère à la maison et que les aveux Noblet-Deleplanque sont une comédie pour le peuple dans laquelle les deux « amis » ont accepté de couvrir M. Léger, avec la promesse qu’il ne leur serait rien fait et qu’ils auraient, en tout cas, des compensations.
Aux Écoutes, Saturday 20 th 1928.
Ce n’est pas parce qu’Aux Écoutes est un hebdomadaire à scandales et prête habituellement une oreille complaisante aux ragots, surtout quand ils sont malveillants, que la rumeur n’existe pas ni que celle-ci ne soit fondée.
D’autres journaux, et pas seulement L’Action française, doutent de la sincérité des aveux de Noblet, rappellent les circonstances où ils ont été obtenus, parlent de moyens dignes de l’Inquisition, soutiennent qu’il a été mis à la Question. C’est assurément exagéré mais on parle de trois inspecteurs qui se seraient relayés pendant des heures pour le faire craquer. Certains affirment qu’on n’en a pas eu besoin, qu’on a seulement « abusé de sa naïveté », qu’on a « utilisé sa faiblesse d’esprit pour lui dicter l’aveu des responsabilités qu’il n’a pas[86] ».
Le Ministère lui-même, dans un communiqué, confirme ces appréciations, « [Noblet] n’aurait été que léger, imprudent et peut-être inintelligent[87] ». Ce faisant, le Ministère apportait involontairement de l’eau au moulin de ses adversaires en rendant plus crédible la thèse d’un abus de faiblesse aux dépens de Noblet.
Les voix qui doutent de ce qu’ils appellent « la thèse du gouvernement » ou « la vérité officielle » n’ont pas été entendues, le scénario imaginé à Cocherel a pu être mis en œuvre et au Conseil, tout s’est passé comme prévu, il a bel et bien été décidé de porter l’affaire devant la Justice.
Ou plutôt de demander à Barthou, le Ministre de la Justice, d’y réfléchir et de l’envisager. In fact, on a frôlé la catastrophe, Barthou ayant d’abord refusé de lancer les opérations. Le jurisconsulte officiel du Quai d’Orsay, le professeur Jules Basdevant, n’y était pas favorable non plus[88].
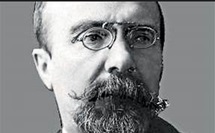 Louis Barthou, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Louis Barthou, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Mais Barthou cèdera au bout d’une pleine semaine et le mardi 23 th, après avoir beaucoup consulté, il permettra que la plainte contre Deleplanque et Noblet soit bien enregistrée et une instruction aussitôt lancée, le lendemain, confiée au Juge Girard[89].
Début de l’instruction (24 th 1928)
Certains détails sont troublants. Par exemple le fait que, au cours des premiers mois, les journaux ont rendu compte en détail des progrès de l’instruction sans que personne ne proteste contre ces atteintes au secret de l’instruction. Les déclarations de Deleplanque et Noblet, interrogés séparément, sont partout retranscrites, de même le déroulé de leur confrontation. Deleplanque avoue et charge Noblet. Celui-ci nie avoir autorisé le journaliste à emporter le document. Aucune protestation du Gouvernement en tout cas : toutes ces informations détournent opportunément l’attention de l’hypothèse d’une fuite organisée.
Autre détail bizarre, le fait qu’au-delà du 27 December, au lendemain d’une ultime audition des deux inculpés dans le bureau du Juge Girard, plus rien n’a transpiré dans la presse. Parce qu’au Gouvernement on a décidé de revenir à une pratique plus régulière ? Ce changement s’explique plutôt par le fait que Girard a été dessaisi de l’affaire et qu’un nouveau Juge, un certain Aubry, a été nommé à sa place. Explication officielle du dessaisissement de Girard : il a été promu Conseiller à la Cour.
Indeed, il a été dessaisi alors qu’il avait très bien travaillé au point qu’on lit ici et là que « l’instruction de l’affaire touche à sa fin[90] », ie, Girard était sur le point de publier sa décision. Le Parquet ne lui en a pas laissé le temps.
Pour quelle raison, dans quel but ce dessaisissement de Girard sinon pour confier l’affaire à un nouveau Juge. Première explication : pour gagner du temps. Obligé de reprendre l’instruction à son début, Aubry ne pourrait prendre sa décision avant un certain temps. L’instruction était sur le point de se conclure au début de janvier 1929, elle ne se conclura que le 20 août suivant. Le Figaro y voit une preuve supplémentaire de l’implication du Gouvernement :
On a fait traîner les choses en longueur – l’ouverture de l’instruction est du mois d’octobre ! Et l’on a choisi l’heure calme des vacances pour liquider cette affaire « ennuyeuse » par un non-lieu. L’étouffoir d’un non-lieu en vacances parlementaires et judiciaires arrangera tout[91].
La décision, rendue en période de vacances, avait plus de chances de passer inaperçue. Et l’affaire d’être oubliée.
Le Juge Aubry ne rendra son ordonnance de non-lieu en faveur de Noblet et Deleplanque que le 20 août 1929.
La plupart des journaux ne considèrent pas comme anormal ni suspect le fait que l’instruction ait duré si longtemps, ils y voient au contraire le signe de ce que la Justice fait bien son travail : l’enquête a été « longue et difficile » (L’Écho de Paris), « longue et minutieuse » (Morning). Le temps de la Justice n’est pas celui des médias, elle a tout à gagner à travailler à son rythme.
Prise plus tôt, l’ordonnance de non-lieu n’aurait pas manqué de surprendre et risquait de déclencher une polémique, tant elle allait à contre-courant de ce que répétait alors la presse, à savoir la gravité des accusations (espionnage et complicité) et des sanctions prévues par la loi.
Mais le dessaisissement de Girard peut ne pas avoir eu pour but de simplement retarder le moment où l’instruction serait déclarée close, le Parquet peut y avoir été contraint eu égard à ce qu’on a su de la décision que le Juge allait prendre. Une décision non conforme aux attentes du Gouvernement.
Quand Girard aura été dessaisi, l’hebdomadaire Aux Écoutes suggèrera que c’est justement pour s’être montré trop curieux que ce Juge, « qui passe pour être un juge sévère », a été remplacé[92]. L’Ami du Peuple confirmera tardivement cette hypothèse :
Les déclarations de Horan au Quai d’Orsay [avaient été] recueillies par le Directeur du service de presse [Bargeton], celui-ci les a condensées dans un rapport adressé au Cabinet. Qu’est devenu ce rapport ? À l’instruction, le premier juge [Girard] le réclama en vain[93].
Girard a été remplacé « À la suite de quelle intervention ? » avait demandé Aux Écoutes. L’Ami du Peuple suggère la réponse : le rapport a été adressé « au Cabinet », dont le Directeur ne nous est pas inconnu.
Le remplaçant de Girard, le Juge Aubry, ne décevra pas le Parquet : il a finalement pris sa décision, in August 1929, sans avoir « jamais touché au dossier pendant cinq mois[94] », il « ne vit ni un inculpé, ni un témoin, ne fit jamais aucun acte d’instruction[95] ». Il avait été nommé pour cela. Ainsi s’expliquerait que la presse, à partir de janvier, n’ait plus rien su des progrès de l’instruction : d’instruction il n’y avait plus.
Charles Maurras, in L’Action française, va plus loin : le Juge Aubry s’est très vite convaincu, comme Girard avant lui, que « la version officielle ne tenait pas debout » mais à la différence de son prédécesseur, il a lui accepté l’idée « qu’il valait mieux ne pas se montrer trop curieux[96] ». This idea, qui en a convaincu le Juge sinon le Gouvernement, en l’occurrence le Ministre de la Justice ? On sait son pouvoir sur les magistrats :
L’opinion générale est que M. Barthou peut compter sur ses magistrats. Il les connaît. Il les a vus à l’œuvre. Il les a commandés, promus, décorés. Il sait parfaitement qu’ils font ce qu’on leur dit et demandent que l’on leur dise.
« Conformément aux conclusions du Parquet Mrs. Aubry, Juge d’instruction, vient de signer une ordonnance de non-lieu en faveur de MM. Roger Deleplanque et Noblet d’Anglure[97] » : cette formule habituelle prend en l’occurrence un singulier relief.
Aubry a signé tout ce qu’on a voulu. Girard son prédécesseur n’avait apparemment pas fait preuve de la même soumission. Revenant sur le dessaisissement de Girard au profit d’Aubry, Le Figaro, en juin 1931, écrira tout net :
Dans son infortune, [Noblet] eut la chance de tomber sur un magistrat intègre, qui chercha sincèrement la vérité.
Non seulement l’instruction consciencieuse de M. Girard fit éclater l’innocence de M. de Noblet, mais il fit clairement connaître l’odieuse machination dont il était la victime. Vainement s’empressa-t-on de changer ce « maladroit » juge d’instruction, le non-lieu s’imposait. Le Figaro, 16 June 1931.
Le comble
Il est un dernier fait qui, plus que tout, peut étonner dans la conduite de l’affaire. Les contemporains ne l’ont pas relevé, ils ont été d’abord tellement assaillis d’informations que, un clou chassant l’autre, ils n’en ont pas perçu l’importance.
Ce fait le voici : dès le début de l’instruction, le jeudi 25 th 1928, avant même les auditions de Deleplanque et Noblet par le Juge Girard, il était clair que l’affaire vraiment « ne tenait pas debout », si bien que le Juge aurait pu (dû) immédiatement déclarer close l’instruction. Il n’en a pas été décidé ainsi.
En effet, ce 25 th, le Juge Girard – il avait été nommé de la veille – a reçu « un amiral au sujet de la valeur secrète que pouvait présenter le compromis franco-anglais sur l’accord naval au point de vue de la défense nationale ». La presse en a aussitôt fait état mais sans révéler ni le nom du militaire ni surtout ce qu’a été sa réponse, aussi bien L’Écho de Paris (cité ci-dessus) que L’Avenir and Excelsior ou en province Le Progrès de la Somme, Le Petit Provençal et bien d’autres. Son identité ne sera dévoilée que le 3 November. Il s’agissait du Contre-amiral Georges Mouget, Sous-chef d’État-Major général à la Marine. Bizarre ce silence d’une dizaine de jours à un moment où la presse était encore parfaitement informée et rendait compte de tout ce qui se passait et se disait dans le bureau du Juge. Pourquoi n’a-t-on pas voulu que la réponse de l’Amiral soit immédiatement connue ? La question portait pourtant sur un point essentiel. Justement, c’est son importance qui explique l’hésitation à la divulguer.
 Contre-Amiral Georges Mouget
Contre-Amiral Georges Mouget
in 1928 Sous-chef d’État major général
La veille du jour où l’Administration a laissé fuiter l’information sur l’audition de l’Amiral, soit le 2 November, le Juge Girard avait reçu Charles Corbin, le Directeur des Affaires politiques et commerciales du Quai d’Orsay, et il lui avait posé les mêmes questions qu’à l’Amiral. Sans résultat. Corbin a répondu qu’« il n’appartenait pas au Département des Affaires étrangères de se prononcer sur le point de savoir si le document disparu intéressait la Défense nationale ou la Sûreté de l’État ». Corbin suggéra que c’est plutôt du côté du ministère de la Marine ou de la Guerre qu’on trouverait la réponse à la question posée.
Le Juge était bien placé pour savoir que la suggestion était judicieuse puisqu’en effet, l’information lui était venue de la Marine. Tôt ou tard elle allait être connue de la presse. Les autorités ont décidé de communiquer elles-mêmes aux journaux la réponse du Contre-amiral pour ne pas être plus tard accusées de rétention d’une information capitale.
La déclaration de Mouget avait été des plus nettes et toute la presse en a rendu compte sur tous les tons dès le 3 novembre et les jours suivants. S’agissant du document publié par Horan, on lit partout : « Ce texte n’avait aucun caractère secret au point de vue militaire[98] », « Les documents n’ont pas le caractère secret au point de vue militaire et au point de vue national[99] », et « pas davantage d’intérêt militaire pour la défense nationale[100] », ni « la sûreté extérieure de l’État[101] ».
[Le juge] a demandé à l’amiral Mouget si les documents livrés à Hearst intéressaient la défense nationale : « Aucunement » a répondu l’amiral.
L’Action française, 3 November 1928.
La question du caractère secret ou non des documents disparus, de leur importance sur le plan militaire et de leur rapport avec la Défense nationale était très exactement, selon l’acte d’accusation, ce pourquoi Deleplanque et Noblet avaient été inculpés. Tous les journaux l’avaient répété. Et voilà que le motif de l’inculpation avait disparu. L’accusation théoriquement devait tomber d’elle-même.
L’Action française, le jour même où la réponse de l’Amiral était connue, en tira les conséquences.
Les représentants du gouvernement ne savent plus s’ils ont un sujet de plainte ! […] Le non-lieu s’impose, dans la jurisprudence de la loi sur l’espionnage, l’inculpation n’ayant plus de fondement.
L’Action française, 3 November 1928.
De même The Work :
On se demande, dans ces conditions, comment la justice pourrait poursuivre une affaire dont se désintéressent ceux-là mêmes qu’elle devrait particulièrement intéresser.
The Work, 3 November 1928.
Que restait-il d’autre dès lors à reprocher à Noblet et Deleplanque sinon des « bagatelles[102] » que le Quai d’Orsay aurait pu traiter en interne. L’instruction aurait pu être immédiatement interrompue. Cela n’a pas été décidé.
Parce que, étant donné le retentissement de l’affaire dans la presse, y compris à l’international, il n’était plus possible de faire autrement. On ne peut imaginer le Juge Girard, au lendemain du jour où il avait commencé son instruction, être autorisé à immédiatement y mettre un terme. Pour le Pouvoir, déjà suspecté de pratiquer, en diplomatie comme en tous domaines, une politique du secret, comment pourrait-il affirmer soudain qu’il n’y a pas d’affaire Horan. Depuis la mi-octobre et jusqu’à la fin de l’année, l’affaire a pris une telle place dans la presse, avec à chaque jour ses révélations, qu’elle a été suivie comme un feuilleton par ses lecteurs : l’opinion n’aurait pas accepté d’être privée de la suite.
Fin de l’instruction – Non-lieux (20 août 1929)
La plupart des journaux ont annoncé les non-lieux en pages intérieures, sans détails. Donner une plus large place à l’information revenait à souligner combien ils avaient été crédules et peu professionnels en insistant sur la gravité d’une affaire qui n’existait pas.
Difficile d’être plus laconique et discret que Le Progrès de la Côte d’or :
L’AFFAIRE HORAN
——
Paris, 20 août
Mrs. Aubry, juge d’instruction, vient de rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de M. Roger Deleplanque et de M. Noblet d’Anglure, inculpés, à la suite de l’affaire Horan, d’espionnage et de complicité.
Le Progrès de la Côte d’Or, 21 août 1929.
Quelquefois, l’affaire n’a même pas droit à un titre, juste à quelques lignes perdues dans une énumération de nouvelles, par exemple dans La Gazette de Biarritz-Bayonne or Le Radical :
Mrs. Deleplanque et de Noblet qui avaient été accusés de divulgation de l’accord naval franco-anglais, bénéficient d’un non-lieu.
La Gazette de Biarritz-Bayonne, 21 août 1929.
L’enquête judiciaire ouverte sur la publication du compromis naval franco-britannique, se termine par un double non-lieu en faveur de MM. de Noblet et Deleplanque.
Le Radical, 25 août 1929.
Time, Le Journal des Débats[103], en général si précis et complets, sont muets sur ce qui a motivé la décision du Juge. Les quelques journaux qui consacrent un article à un rapide historique des faits le terminent tous par la même formule :
Après une longue instruction, Mrs. Aubry vient de signer en faveur [de Deleplanque et Noblet] une ordonnance de non-lieu et a avisé leurs avocats de sa décision[104].
Seul l’hebdomadaire L’Ère nouvelle a osé évoquer, à mots couverts, ce qui a motivé le Juge, au risque d’être complètement incompréhensible. Comment en effet, après avoir rappelé que Deleplanque et Noblet étaient suspectés d’espionnage et complicité, se contenter d’écrire :
Cette « fuite » [du document] ne présentant pas les caractéristiques d’un délit[105]…
Seul Cross osera être explicite, mais trois mois après que les ordonnances furent prononcées, écrivant, the 17 November 1929 :
Le juge d’instruction [a] estimé qu’il ne s’agissait pas d’un secret concernant la défense nationale.
Personne n’est allé plus loin, du moins en France. Il en va autrement à l’étranger, spécialement aux États-Unis, où on lit un peu partout :
An investigating magistrate rules there was no ground for prosecution of the Count on charges of espionage and plotting against the security of the State[106].
Fin de partie ?
Les non-lieux vont-ils clore l’affaire ? Nombre de journaux l’ont aussitôt affirmé, entre beaucoup d’autres :
L’affaire de la divulgation de l’accord franco-anglais se termine par un non-lieu.
L’Avenir
Un non-lieu clôture l’affaire de la divulgation du compromis naval franco-britannique.
L’Express de Mulhouse
Voilà qui pourrait rassurer les personnes impliquées, quelles qu’elles soient, spécialement au Gouvernement.
Mais la plupart des journaux annoncent avec raison non pas la fin de l’affaire mais la fin de l’instruction, ce qui n’est pas la même chose. Même si une instruction est déclarée close, le Parquet, sous l’autorité du Ministre de la Justice, a la possibilité d’ouvrir une nouvelle instruction sur de nouvelles bases.
Force est de constater que le Gouvernement, him, a choisi de considérer l’affaire comme close puisque le Parquet, qui aurait pu ouvrir une nouvelle instruction, n’en a rien fait.
Dans l’opinion en revanche, l’affaire n’est pas close, d’abord parce que la presse d’opposition, pendant les mois qui suivent, va s’employer à répéter périodiquement que, sur le fond, trop de zones d’ombre subsistent, que la conduite des enquêtes par les autorités n’a tendu qu’à éviter un scandale d’État. À elle seule, la presse d’opposition avait-elle le pouvoir de faire redémarrer l’affaire ?
C’est Noblet qui, contre toute attente, obtiendra ce résultat. À l’annonce des non-lieux, sa réaction, en privé, a été de dire son refus d’en rester là. Le jour même, in L’Action française, qui de toute la presse semble l’avoir approché de plus près, Charles Maurras en témoigne :
Nous ne savons pas ce que fera M. Deleplanque. Nous croyons savoir que M. de Noblet n’en restera pas là.
L’Action française, 21 août 1929.
Maurras n’en dit pas plus, il ne dévoile pas ce que sera la stratégie de Noblet, ce qui serait contre productif dans le combat qui va se poursuivre. Face à « la justice [that] a senti le péril d’un débat public », d’où les non-lieux dont ont bénéficié Deleplanque et Noblet, il est probable que ceux-ci, qui pendant l’instruction « se sont si bien défendus en attaquant[107] », vont persévérer dans cette voie. Cross, qui semble avoir également bénéficié de confidences de Noblet, confirme le lendemain son insatisfaction et donne une indication sur ce que sera sa cible, si effectivement attaque il y a :
Ce dernier [Noblet] ne se déclare pas satisfait et prétend qu’il fut victime de chefs peu scrupuleux. Il proteste énergiquement contre la façon dont cette affaire a été progressivement étouffée.
Maurras a été le premier à avoir pressenti que Noblet n’était pas le fonctionnaire soumis et silencieux et peut-être « inintelligent » qu’un communiqué officieux avait présenté à l’opinion.
Noblet déclenche les hostilités (23 août 1929)
The 10 août, alors que l’instruction judiciaire qui allait aboutir aux non-lieux était encore en cours, ainsi que, pensons-nous, cela lui avait été promis Noblet a demandé par lettre sa réintégration à son administration. Une lettre vraisemblablement déférente, Noblet n’avait alors aucune raison de douter des promesses qui lui avaient été faites[108].
C’est bien peu de jours après que le Juge eut décidé de clore son instruction par des non-lieux que Noblet va, par une première déclaration à la presse, entrer publiquement en rébellion contre son Administration[109]. La décision était du 20 août, elle avait été rendue publique le 21, sa déclaration est dans les journaux à partir du 23.
Il n’y mentionne pas ces « chefs peu scrupuleux » qu’il avait évoqués en privé devant les journalistes de Cross. Son « attaque » est très dosée. C’est que Noblet comme Deleplanque sont très bien conseillés par des avocats très compétents, doués d’une forte personnalité, déjà célèbres pour certains, en passe de l’être pour d’autres comme Me César Campinchi, choisi par Noblet, Mrses Henry Torrès, Gérard Rosenthal et Gérard Strauss choisis par Deleplanque. Plusieurs sont ou seront députés, voire ministres[110].
 Jean de Noblet (à gauche) et Me César Campinchi.
Jean de Noblet (à gauche) et Me César Campinchi.
Pas d’attaques ad hominem certes dans l’attaque de Noblet mais celle-ci n’en est pas moins forte aussi son texte vaut-il d’être connu. Il a paru dans de nombreux journaux tant à Paris qu’en province[111].
Une des affirmations de Noblet est redoutable et ne sera pas contestée : il avait quitté le Ministère, pour prendre ses congés annuels, le jour même où Deleplanque lui aurait subtilisé la circulaire de Berthelot, Saturday 15 September 1928, et n’y était revenu que rappelé par un télégramme, Wednesday, 10 th. Dès son arrivée à Paris, il avait été immédiatement interrogé par la Police, sans être repassé par son bureau au Ministère… où le document censé avoir été confié à Deleplanque était toujours au coffre. Pour tous ou presque, il est clair qu’il est donc complètement innocent de ce dont on l’avait accusé.
Sa déclaration à la presse a été publiée à partir du 23 août. Deleplanque lui aussi a peu après fait une déclaration pour accuser Noblet d’avoir travesti la vérité[112]. Rien ne va plus entre les deux hommes, si tant est qu’ils aient été proches un jour. Noblet dira plus tard avoir contesté les non-lieux au seul motif que Deleplanque avait été innocenté en même temps que lui-même alors que le journaliste avait reconnu son rôle dans la fuite du document, pas lui[113].
L’innocence de Noblet ayant été reconnue par nombre de journaux, ceux-ci en ont tiré les conséquences et sont très critiques envers les autorités, accusées d’avoir voulu faire admettre une « vérité officielle », une « fable ». On répète ici et là que Noblet dans l’affaire ne serait qu’un « bouc émissaire », que les vrais criminels sont ailleurs. Sale temps pour les hauts fonctionnaires si, comme le bruit en court depuis le début de l’affaire, tel ou tel d’entre eux allait être identifié.
Certains, redisant la sentence latine : Is fecit cui prodest, ont assuré qu’il y avait au Quai d’Orsay un haut fonctionnaire qui devait tirer bénéfice d’un scandale dont l’accord franco-britannique ferait les frais[114].
Noblet continue à ne donner aucun nom, se bornant à écrire que « la responsabilité de la fuite n’incombe pas à [s]on service ». Maurras dans L’Action française le pousse à aller plus loin :
Félicitons M. de Noblet à qui, tout de même, il a bien fallu rendre justice ! Mais nous espérons bien qu’il exigera deux choses :
– des réparations personnelles et professionnelles,
– la publication de la vérité.
Vous verrez bien qu’on y viendra. Ou qu’on saura pourquoi !
Ce non-lieu, Noblet l’attendait pour autant qu’il avait, sous la pression de ses chefs, accepté de jouer provisoirement le rôle de bouc émissaire. Mais un simple non-lieu ne pouvait le satisfaire : même s’il se considère – et la presse avec lui – comme blanchi, son innocence n’a pas encore été officiellement et publiquement reconnue.
Au Quai d’Orsay, on avait apparemment espéré lui donner satisfaction – et clore l’affaire – en lui proposant une nouvelle affectation. Fin septembre, dans l’hebdomadaire Comoedia, on pouvait lire :
Mrs. de Noblet, qu’un non-lieu a blanchi dans l’affaire du document évanoui au Quai d’Orsay, reprendra-t-il sa place au service de presse du ministère des Affaires étrangères ? Logiquement, il le devrait, car, enfin, un non-lieu signifie, en bon français, qu’il n’y avait pas lieu à des poursuites ; then ?
Mais la Carrière est assez vaste pour qu’on donne à ce fonctionnaire, murmure-t-on déjà, un poste aussi important mais moins délicat[115]…
En mars déjà, selon La Libre Parole Républicaine, alors que son non-lieu n’avait pas encore été prononcé, on avait pensé à « lui confier un poste consulaire et lointain, où il se ferait oublier[116]… ».
Mais comment Noblet aurait-il pu accepter une telle proposition ? Il a demandé le 10 août la convocation d’un nouveau Conseil de discipline qui le réintégrerait, en vain, à la fin du mois il ne lui avait pas encore été répondu, also, the 29, peu de jours après sa déclaration à la presse, il renouvelle sa demande par une deuxième lettre à Briand[117].
Noblet sanctionné (12 November 1929)
Il sera accédé à sa demande du 10 août, renouvelée le 29, un Conseil de discipline sera bien convoqué, the 12 November 1929, et Noblet y sera entendu, assisté d’un nouvel avocat, Mrse Georges Scapini[118], pendant plus de quatre heures, from 15 p. m. 30 at 20 p. m..
Le Conseil a réglementairement été présidé par le Directeur des Affaires politiques et commerciales, Charles Corbin, les membres en sont Émile Charvériat, Paul Bargeton, Gaston Bernard et Claude Béart de Boisanger, rapporteur Georges Harismendy. On verra l’importance de tels détails.
Une difficulté semble avoir émergé car le Conseil délibèrera encore, hors de la présence de Noblet, le lendemain et encore le surlendemain.
Pour quel résultat ? Noblet était alors en disponibilité avec traitement, il attendait sa réintégration : il est, par décret, Friday, May 15 November, après validation de la décision du Conseil par le Ministre, suspendu sans traitement pour une période de deux ans. Le voilà, comme l’écriront Excelsior and Le Petit Journal, en position de « non-activité par retrait d’emploi[119] ». Les journaux donnent tous l’information le 16.
La sévérité de la sanction que lui inflige son Administration tranche avec l’indulgence affichée auparavant.
Dans l’ignorance où ils sont quant à ce qui la justifie, certains journaux annoncent la sanction infligée à Noblet sans préciser ce qui la motive. Plusieurs[120] ont continué à croire, wrongly, que c’est « l’affaire de détournement du compromis naval » qui a motivé la sanction. Ce motif peut d’autant moins être invoqué qu’il est clair que « l’affaire de détournement du compromis naval ne fut pas évoquée[121] » en séance.
Plusieurs évoquent une « faute professionnelle » sans plus de précision. Beaucoup se sont bornés à reproduire le communiqué du Quai d’Orsay, lequel est ou semble plus précis : Noblet a été sanctionné pour « un ensemble de fautes professionnelles constituant des manquements à la discipline et engageant seulement sa responsabilité administrative ». Force est de constater que ce communiqué laisse lui aussi le lecteur dans l’ignorance de la nature exacte des fautes évoquées.
Double contre-offensive de Noblet : il dépose deux plaintes contre X et se pourvoit en Conseil d’État (16 and 20 November 1929)
Ce qu’on sait en revanche, c’est que Noblet n’a pas supporté la sanction. Dès le samedi 16 November, au lendemain du décret qui l’a suspendu, il dépose deux plaintes contre X, l’une contre la Police, pour sévices, l’autre pour contester la sanction dont son Administration l’a frappé. Réflexion faite, pour le deuxième point, il ouvre quelques jours plus tard, the 20 November, un autre front en se tournant vers le Conseil d’État dont une des fonctions est justement de trancher les litiges qui opposent les citoyens, entreprises et associations, aux Administrations. C’est la plus haute juridiction administrative en France.
Le Journal est le premier à annoncer ce pourvoi, l’information est donnée le lendemain dans Time and Le Journal des Débats and from 23 dans tous les autres journaux.
Mrs. de Noblet fait appel
——
Mrs. de Noblet vient de faire appel devant le Conseil d’État de la peine le frappant de deux ans de suspension, récemment prononcée par un Conseil de discipline devant lequel il avait comparu.
Le Journal, 20 November 1929
L’information est partout donnée mais sans grands commentaires sauf dans L’Action française dont le Rédacteur en chef, Maurice Pujo, applaudit bruyamment, dit son soutien à Noblet dans son action et sonne la charge contre Briand et sa « bande de coquins » :
Elle va fort la bande de coquins qui entoure Briand ! Mais elle ne saurait mieux avouer son désir de sauver à tout prix les vrais coupables, ceux qui ont vendu à Hearst les fameux documents. Mrs. de Noblet, qui a refusé de se laisser charger de leur crime et qui a prétendu demander raison des procédés odieux par lesquels on l’avait essayé, continue à être récalcitrant. Il maintient sa plainte et se pourvoit en Conseil d’État. Il n’a pas tort, et toute l’opinion le soutiendra. Que les vendus le veuillent ou non, cette affaire sera tirée au clair.
L’Action française, 23 November 1929.
Note de l’avocat de Noblet dans la presse (23 November 1929)
L’avocat de Noblet, Mrse Scapini, dans une note publiée le 23, a évoqué le dépôt par Noblet de ses plaintes et expliqué le pourvoi en Conseil d’État. Ces deux combats de Noblet sont complémentaires : la plainte pour sévices concerne des faits qui se sont déroulés « au début de l’affaire », le pourvoi en Conseil d’État va traiter de l’avenir de Noblet, à savoir sa réintégration éventuelle. Motif du pourvoi : bien que figurant à l’ordre du jour du Conseil de discipline, sa demande de réintégration n’y a pas été évoquée. Cela s’appelle un « refus d’informer ».
Il est clair que Noblet, avec ce pourvoi a un compte à régler avec le ou les responsables des mauvais traitements qu’il continue de connaître au sein de son Administration. Un compte à régler publiquement, devant la justice et la presse, et non dans le cadre feutré et discret du Ministère.
Dans la note que son avocat, Mrse Scapini, a adressée à une dizaine de journaux[122], on apprend enfin pourquoi Noblet avait été suspendu :
Les manquements à la discipline auraient consisté spécialement dans le fait que M. de Noblet a saisi directement le Ministre d’une plainte contre l’action policière et administrative poursuivie contre lui au début de l’affaire.
Morning, 23 November 1929.
La note fait état d’un premier grief, celui d’avoir par lettre « saisi directement le Ministre » au lieu de suivre la voie hiérarchique et, second grief, de s’y être plaint de la manière dont il a été traité par la Police judiciaire, d’une part, ce qui n’est peut-être pas le plus grave, mais il s’est plaint aussi de sa propre Administration. La lettre de Noblet en date du 29 août ne faisait pas état de cette seconde plainte. Noblet l’aurait-il évoquée dans une autre lettre à son Ministre[123] ? Comment les hauts fonctionnaires qui composent le Conseil de discipline de son ministère et le Ministre lui-même auraient-ils pu ne pas s’en irriter ?
Les contemporains n’ont pas eu connaissance de cette lettre, la presse ne l’a pas publiée. C’est pourtant elle et elle seule qui a amené le Conseil de discipline à sanctionner Noblet et non ses plaintes auprès du Procureur de la République qui sont postérieures à la sanction, qui en sont la conséquence et non la cause. Cette lettre à Briand ni le rapport confidentiel qui lui était joint n’ont été publiés, tout au plus en sera-t-il question dans la presse mais bien plus tard, quand Noblet sera parvenu au terme du parcours judiciaire qu’il initie en ce mois de novembre 1929[124].
Pour l’heure, les deux plaintes déposées par Noblet le 16 novembre « contre l’action policière et administrative » sont évoquées dans la plupart des journaux le jour même mais sans commentaire aucun. Quelques-uns, au sujet de ce qui avait motivé Noblet dans son dépôt de plainte, se bornent à évoquer le dépôt par lui d’« une plainte contre la Police judiciaire, coupable de sévices envers lui[125] », sans rien dire de la plainte contre « l’action administrative ».
Mrs. de Noblet, interrogé il y a treize mois par la police judiciaire avec quelque… rudesse, a déposé une plainte contre les sévices dont il a été l’objet.
The Work, 16 November 1929.
Dans les locaux de la police judiciaire, […] au cours de [son] interrogatoire, on lui a, par certains procédés, arraché de force une déclaration constatant qu’il avait communiqué le document secret à M. Deleplanque.
La Petite Gironde, Le Petit Marseillais, 17 November 1929.
Ont-ils reçu la consigne de se limiter à ce seul versant de la plainte déposée par Noblet ? S’agit-il d’auto-censure ? Leur prudence en ce qui concerne la plainte contre le Quai d’Orsay, la « plainte administrative », est signe qu’ils ont perçu sa particulière gravité.
La Dépêche, de Toulouse, est le seul journal à évoquer, dès le 16, une double plainte, et il faudra attendre une semaine avant que d’autres fassent de même, et encore, sans assumer personnellement ce qu’ils publient, se bornant à reproduire, the 23 November, la note de l’avocat de Noblet[126]. Toujours sans commentaire. Une fois encore, comment expliquer cette abstention sinon par le fait qu’ils n’ont pas vu – ou plutôt pas voulu attirer l’attention sur – le nouveau tour que prenait l’affaire.
Pour la plainte contre la Police, pas de problème, on savait depuis le 16 que Noblet avait subi des sévices, ils sont cette fois rapidement évoqués :
Dans cette plainte, Mrs. de Noblet relate les faits : the 10 th 1928, il fut brusquement rappelé de congé et convoqué à la Préfecture de police. Il déféra aussitôt à cette convocation et subit un interrogatoire pendant toute la matinée et une grande partie de l’après-midi. À quatre heures du matin, il n’était pas encore relâché[127].
Il en va autrement pour la plainte de Noblet contre son Ministère, d’autant qu’elle cible manifestement, sans pour autant le nommer, un responsable et sa « mauvaise foi ».
D’autre part, ajoute le Secrétaire d’ambassade, c’est avec une mauvaise foi manifeste que l’on a déposé une plainte contre moi : Mrs. Hearst possédait en effet l’original du texte qui avait trait au compromis franco-anglais ; moi, je n’étais en possession que d’une copie et cette copie a été retrouvée dans mon coffre-fort.
La Dépêche, 8 avril 1930
Noblet ne nomme personne. Les plaintes en effet, officiellement, ne sont pas nominales et aucun journal n’ose pour l’heure révéler le nom du ou des fonctionnaires visés, il faudra attendre plusieurs mois avant qu’ils ne le soient.
L’Administration ne manque pas de moyens pour faire obstacle aux initiatives de Noblet. Trois mois après que Noblet eut déposé son pourvoi, the 18 janvier 1930, Mrse Scapini est informé qu’il « n’a pas qualité pour plaider devant le Conseil d’État », que Noblet devrait donc théoriquement lui trouver un remplaçant mais que cela ne sera pas possible parce qu’il « est forclos, ne s’étant pas pourvu dans le délai légal de deux mois à courir de la notification, qui expirait hier[128] ».
Il aura fallu plusieurs mois à l’Administration pour s’en rendre compte ? Comment ne pas voir là une manœuvre pour empêcher que le pourvoi de Noblet ne soit enregistré ? Ce qui le fait penser, c’est que, ainsi que certains le suggèrent, la date du 17 janvier, présentée comme limite, pourrait n’être fondée sur rien. C’est du moins ce que suggèrent à l’unisson Le Petit Journal et l’hebdomadaire Excelsior, après que finalement le pourvoi eut été enregistré :
Mrs. DE NOBLET S’EST POURVU DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
——
Par le ministère de Me Lussan, Mrs. de Noblet d’Anglure, Secrétaire d’ambassade, s’est pourvu le 18 janvier, dans la soirée – date extrême, paraît-il[129] – contre la décision du Ministre des Affaires étrangères en date du 15 novembre dernier, le mettant en non-activité par retrait d’emploi, pour une période de deux années.
Le Petit Journal, 23 janvier 1930
Il est exclu que Noblet, en quelques heures, le jour même où il aurait appris par la presse que son pourvoi n’avait pas été reçu et que son avocat n’était pas autorisé à le défendre, soit parvenu à trouver un nouvel avocat, à réfléchir avec lui à sa riposte et à rédiger son pourvoi. Nul doute qu’au Ministère, où il travaillait depuis le printemps 1927, il avait des alliés et que ceux-ci l’ont prévenu de ce qui se préparait contre lui avant que la décision ne soit officielle.
Toujours est-il que ce même 18 janvier 1930, un nouvel avocat, dûment autorisé à plaider devant le Conseil d’État, Mrse Philippe Lussan[130], a réussi à faire enregistrer le pourvoi de Noblet dans la soirée, bien que hors délai… « paraît-il ».
À aucun moment, dans les six mois qui vont suivre, la presse n’évoquera le sort réservé à la requête de Noblet, pas même pour rappeler que le Conseil d’État tarde à rendre son verdict. En fait il ne tarde pas, il travaille à son rythme.
Le Conseil d’État ne se prononcera pas sur le pourvoi de Noblet, du moins pas sur celui-ci. Son pourvoi est tombé de lui-même du fait d’un nouveau décret de Briand intervenu entretemps. Un premier décret avait suspendu Noblet de toute fonction au Ministère pour une durée de deux ans, un nouveau décret a été pris à son encontre, et autrement plus grave[131]. À situation nouvelle, then, nouveau pourvoi devant le Conseil d’État. Comme sa décision peut ne pas intervenir rapidement et que Noblet n’est plus d’humeur à attendre sans rien tenter, il en appelle de nouveau à l’opinion via la presse, comme une fois déjà, the 23 août 1930, pour faire reconnaître son bon droit.
Sort de la double plainte déposée par Noblet (avril 1930)
Noblet avait, en novembre 1929, déposé une double plainte contre « l’action policière et administrative ». Au bout de plusieurs mois d’attente, Noblet a-t-il pensé que son avocat, Mrse Scapini, n’avait pas fait tout ce qu’il était possible de faire pour accélérer le mouvement ? Il va changer de conseil au profit d’un nouvel avocat, Mrse Olivier Jallu, qu’il espère plus efficace.
Il avait d’abord déposé une double plainte dite « simple », or une telle plainte n’oblige pas le Parquet à donner suite et de fait, la plainte de Noblet n’a rien enclenché. Mais au bout de trois mois, un plaignant a la possibilité d’obliger le Parquet à nommer un Juge d’instruction, il suffit pour cela de confirmer sa plainte en se constituant partie civile. C’est précisément ce qu’a fait Noblet, bien conseillé par son nouvel avocat.
Résultat quasi immédiat, le lundi 7 avril 1930 après-midi, peu de jours après avoir confirmé sa plainte et s’être constitué partie civile, Noblet a été reçu avec Me Jallu par un Juge d’instruction, Bracq[132].
À cette occasion, l’objet de la plainte, « action policière et administrative », a été précisé, il est devenu « arrestation arbitraire et dénonciation calomnieuse ». La nouvelle formulation est dans tous les journaux à partir du lendemain.
Comme en novembre, cette double plainte est officiellement déposée « contre inconnu » (on dit aussi, alors comme aujourd’hui, « plainte contre X ») mais le nom des personnes visées va très tôt apparaître dans la presse.
S’agissant de la plainte pour arrestation arbitraire…
Le motif de la nouvelle plainte déposée par Noblet est inchangé par rapport à celle qu’il avait déposée en novembre (les sévices subis par Noblet pendant son interrogatoire). S’y ajoute maintenant le fait qu’il a été « détenu sans mandat[133] ».
Le nom de la personne ciblée apparaît dans la presse deux jours après le début de l’instruction, soit le mercredi 9 avril. Léon Daudet est le premier à avancer un nom :
Je crois savoir que le commissaire Faux-Pas-Bidet – de l’affaire Koutiepoff[134] – est sérieusement compromis dans cette très grave affaire.
L’Action française, 9 avril 1930.
Le samedi 12 July, Daudet se fait plus affirmatif :
Son rôle dans l’affaire de de Noblet d’Anglure n’a pas été beau.
 Charles Adolphe Faux-Pas-Bidet
Charles Adolphe Faux-Pas-Bidet
Faux-Pas-Bidet est, à la Préfecture de Police, quai des Orfèvres, un des commissaires du service des Renseignements généraux[135] mais partiellement détaché à la Sûreté générale, rue des Saussaies. Le plus important à savoir pour nous : il est, in the dark, un proche de Briand. « À sa botte » dit Léon Daudet[136]. C’est un électron libre qui semble ne dépendre que de Briand au point qu’à la mort de ce dernier, le policier sera immédiatement mis d’office à la retraite[137].
Il nous faut nous attarder sur ce personnage car étant proche de Briand, il ne peut pas ne pas l’être aussi de Leger.
« Le terrible Faux-Pas-Bidet[138] » est bien connu pour son efficacité. C’est lui qui, le lundi 8 th 1928, au tout début de l’affaire, avait intercepté Horan rue de la Paix et l’avait amené à la Préfecture de Police puis l’y avait interrogé. À l’époque, son nom n’avait pas été mentionné dans les journaux sauf une fois, marginalement, quand il avait dirigé les perquisitions opérées chez Deleplanque et Noblet à la demande du Juge Girard[139]. Horan s’était plaint dans la presse de la brutalité du policier. Devant le Juge, Noblet a dénoncé cette même brutalité quand Faux-Pas-Bidet l’avait lui aussi interrogé, Wednesday, 10 th.
Des progrès de l’instruction, rien ne transpire dans la presse jusqu’au moment où le Juge fera connaître sa décision, the 11 juillet suivant. À cette occasion Le Figaro croit pouvoir affirmer que dès le début, contrairement à ce qui avait été dit, « la plainte pour arrestation arbitraire […] visait M. Faupas-Bidet [sic], commissaire de police ». La décision du Juge est dans quelques journaux mais non tous[140] : non-lieu.
En sa qualité d’officier de police judiciaire, [il] n’est justiciable que de la Chambre civile. En conséquence, le procureur de la République s’est déclaré incompétent et a invité le plaignant à se pourvoir vers le Parquet général.
Le Figaro, Saturday 12 July 1930.
Commentaire de L’Action française :
Le procureur et le juge se sont aperçus tout à coup, alors que la plainte remonte au mois de mars, qu’ils étaient incompétents pour examiner les faits à sa charge. […] Après trois mois de réflexion.
L’Action française, Saturday 12 July 1930.
Ce n’est pas la première fois que la publication d’une décision de justice aurait été artificiellement retardée. En l’occurrence, il est possible qu’on ait seulement voulu attendre la fin de l’instruction de l’autre plainte, celle qui porte sur une « dénonciation calomnieuse », pour pouvoir annoncer le même jour les deux décisions.
Nous n’en avons pas fini avec Faux-Pas-Bidet car à l’occasion de l’évocation de la seconde plainte, il va être encore beaucoup question de la Police et des liens très étroits existant entre elle et certains membres du Quai d’Orsay. À commencer par celui ou ceux qui sont visés par cette plainte.
S’agissant de la plainte pour dénonciation calomnieuse…
Tout comme pour la plainte pour séquestration arbitraire, celle autre plainte n’est pas demeurée longtemps « contre inconnu ».
Pour justifier sa nouvelle plainte, prouver son innocence et montrer l’injustice de sa dénonciation, Noblet a cette fois rappelé que « le caractère secret du document, indispensable pour l’application de la loi sur l’espionnage […] faisait défaut en l’occurrence ». L’argument aurait pu échapper au Juge, tant la déposition du Contre-amiral Mouget, qui en avait informé le Juge Girard au tout début de son instruction, avait peu été évoquée dans la presse[141]. Pour autant, Noblet n’illustre pas le caractère non secret du document en se référant à la déposition de Mouget mais par le fait qu’il avait finalement été publié[142].
Quant à la ou les personnes qui, au Ministère, « de mauvaise foi », l’ont dénoncé, leur nom sera très vite livré à l’opinion. Dès le lendemain du dépôt de la plainte, Tuesday 8 avril, Léon Daudet, in L’Action française, sans nommet personne, en dit assez pour qu’on devine de qui il s’agit :
Mrs. de Noblet appuie la dénonciation calomnieuse de quelques autres considérations qui ne manqueront pas de procurer à certain haut-fonctionnaire du Quai d’Orsay les plus vives inquiétudes.
L’Action française, on Tuesday 8 avril 1930.
Le surlendemain, mercredi 9 avril, Daudet donne enfin – et il est le premier – le nom de ce haut-fonctionnaire : la plainte vise
le ténébreux Léger, lequel a remplacé Philippe Berthelot dans la faveur de Briand, le Chevelu dessus son pot.
Léger a joué […] un rôle souterrain dans l’histoire, […] il passe pour être à cheval sur la police politique et les Affaires étrangères. J’ai déjà dit qu’il avait un entourage extrêmement suspect. Bref c’est un homme à surveiller. […] Quel cloaque est devenu le Quai d’Orsay !
Si énorme que soit l’information, ou justement parce qu’elle l’est, elle n’est reprise par aucun journal alors qu’ordinairement, ils se citent assez systématiquement les uns les autres, aussi bien quand ils partagent les mêmes idées que pour les discuter. En l’occurrence, Nothing. Même Le Figaro, en général très prompt à emboîter le pas à L’Action française, s’abstient de réagir.
De l’instruction en cours, on n’entendra pas parler pendant des mois. L’époque où la presse était informée de tout ce qui se disait dans le Cabinet du Juge Girard est décidément révolue. Protestations dans L’Action française and in Le Figaro : « Depuis trois mois, le plus épais mystère a enveloppé l’instruction de M. le juge Bracq », pourquoi ce « mur de journaux silencieux [that] s’étend au-devant de M. Briand, de M. Léger, des coupables », si ce n’est à la suite d’« une demande officieuse de silence adressée à la presse par le Parquet[143] ? ».
La presse n’en reparlera que lorsque l’instruction sera déclarée close, trois mois plus tard, Friday, May 11 July 1930. Le Juge Bracq a pris sa décision dans la journée, le décret de clôture de l’instruction a été lu devant les journalistes dans la soirée par le Président du Conseil des ministres lui-même, André Tardieu, et la nouvelle est publiée le lendemain.
La plainte de Noblet est rejetée, Army, comme Faux-Pas-Bidet, bénéficie d’un non-lieu.
En ce qui concerne la seconde plainte en dénonciation calomnieuse, qui visait M. Léger, Directeur au ministère des affaires étrangères, le Ministre ayant couvert son subordonné, Mrs. Brack, juge d’instruction, a clôturé l’affaire par un non-lieu.
Le Figaro, Saturday 12 July 1930.
L’Action française publiera également le nom de Leger ce même 12 July, associé à celui du commissaire Faux-Pas-Bidet dont il dit :
Dans l’affaire de de Noblet d’Anglure, […] il agissait pour le compte de Léger, le sinistre bras droit de Briand.
Est-ce que Charles Maurras, dans les jours qui ont précédé, a été informé du fait que la décision était imminente ? Faut-il parler d’intuition ? De coïncidence ? Toujours est-il que dans L’Action française Friday 11 July, écrit la veille, avant qu’aucune décision n’ait été officiellement prise, Maurras a mené un ultime assaut en faveur de Noblet et contre Leger. Dans un long article très structuré, une vraie plaidoirie.
Après avoir repris point par point l’affaire à son début, il y confirmait et dénonçait plusieurs faits mis à jour pendant l’instruction, tous accablants pour Leger et pour Briand. Le Figaro cette fois a suivi et reproduit la quasi-totalité du texte dans son édition du lendemain.
Quand les non-lieux auront été publiés, L’Action française redonnera les mêmes informations, non plus comme éléments d’une plaidoirie mais comme protestation véhémente contre la décision prise. En y ajoutant de nouveaux faits, jusqu’ici inconnus, avec preuves à l’appui. Indiscutables et d’ailleurs indiscutés. Personne n’a opposé de démenti. Le texte sera repris d’abord par le seul Figaro, puis par plusieurs autres journaux.
Une instruction complexe
Qu’apprend-on ?
Que le Ministre des Affaires étrangères a écrit au Ministre de la Justice pour couvrir Leger au mépris d’un des fondements de la démocratie, à savoir l’indépendance de l’ordre judiciaire par rapport à l’exécutif.
Mrs. Briand, se portant au secours de son collaborateur immédiat, aurait écrit au ministère de la Justice pour prendre l’entière responsabilité des faits délictueux reprochés à M. Léger.
L’Action française, Friday 11 July 1930,
cité dans Le Figaro le lendemain.
Ce qui est ici avancé au conditionnel (le Ministre « aurait écrit ») ne sera plus douteux dès lors que la lettre de Briand aura été reproduite in extenso trois semaines plus tard :
Dépêche du Ministre des Affaires étrangères relative à l’information ouverte sur la plainte de M. de Noblet
Paris, the 21 mai 1930.
Le Ministre des Affaires étrangères
à monsieur le Garde des Sceaux
Par lettre du 9 mai, sous le n° 20 B.L.301 C.F., vous m’avez fait savoir que le juge d’instruction chargé d’informer sur la plainte portée par M. de Noblet, pour arrestation arbitraire et dénonciation calomnieuse, pouvait être amené à entendre comme témoin M. Léger, Chef de mon Cabinet.
J’ai l’honneur de vous remercier de cette communication.
Je dois néanmoins observer qu’en aucun cas et à aucun titre, la responsabilité personnelle de M. Léger ne saurait être mise en cause dans une affaire où il n’a jamais eu à intervenir qu’administrativement, sur mon ordre et sous mon contrôle, c’est-à-dire en constant accord avec moi, pour transmission ou exécution de mes instructions.
Je ne saurais donc admettre que le Chef de mon Cabinet eût à répondre de ses actes administratifs, accomplis sous ma seule autorité.
J’ajoute, en ce qui concerne la plainte en dénonciation calomnieuse de M. de Noblet, que mon département n’ayant jamais rien eu à requérir dans cette affaire que l’instruction complète et régulière jugée nécessaire par le gouvernement, n’a pu, à aucun moment, formuler contre personne de dénonciation d’aucune sorte.
Aristide BRIAND
L’Action française, 7 août 1930.
Autrement dit,
Mrs. Briand avait « ordonné » un délit. Un délit de Ministre, un délit de Puissant ne peut recevoir de sanction !
Le Figaro, Saturday 12 July 1930.
Variante non moins ironique :
Le délit de M. Léger a été ordonné par moi : il n’y a donc pas de délit.
L’Action française, 16 July 1930.
Autre information au conditionnel mais bientôt confirmée, autre atteinte au principe de l’indépendance des pouvoirs, Briand a carrément demandé l’arrêt immédiat de l’information.
Refusant de s’expliquer sur les faits, Mrs. Briand aurait exigé en même temps l’arrêt immédiat de l’instruction et la justice s’apprêterait à obéir à cette extraordinaire exigence en terminant la procédure sans PROCÉDER À AUCUNE INFORMATION.
Ce fait est un scandale sans précédent.
L’Action française, Friday 11 July 1930,
cité par Le Figaro le lendemain.
Comments :
À notre tour de poser cette première question : la lettre d’un Ministre à un autre Ministre suffirait-elle à interrompre une instruction judiciaire ?
Le Figaro, Saturday 12 July 1930.
L’oukase de Briand à la Justice pour l’inviter à cesser ses poursuites, à rendre un non-lieu et clore l’instruction sans procéder à aucune information, constitue un fait sans précédent.
L’Action française, Sunday 13 July 1930,
cité dans Le Figaro le lendemain.
La lettre de Briand à Barthou, le Ministre de la Justice, est du 21 mai. Il n’est pas sûr que ce dernier ait poussé le Juge Bracq, en charge de l’instruction, à en tenir compte[144], les deux ministres ne sont en effet pas d’accord sur la conduite de l’affaire et Barthou n’a nulle envie de complaire à son collègue.
Le Juge a écrit à Briand pour le prévenir qu’il avait l’intention d’entendre Leger comme témoin. Refus du Ministre.
Bracq persévéra, Barthou a cédé et Leger fut bel et bien inculpé.
Léger, soutenu par Briand refusa d’aller témoigner.
Dans ces conditions, le juge inculpa Léger.
L’Action française, 24 July 1930.
Le voilà « inculpé pour avoir mensongèrement accusé M. de Noblet de la communication du pacte naval franco-anglais dont il est lui, Léger, seul responsable[145] ».
L’Action française s’en réjouit en caractères majuscules :
Les faits de dénonciation calomnieuse étant surabondamment démontrés, Mrs. LÉGER, CHEF DE CABINET DE M. BRIAND, qui avait signé le rapport administratif contre M. de Noblet, A ÉTÉ INCULPÉ PAR M. BRACQ.
L’Action française, Friday 11 July 1930,
cité dans Le Figaro le lendemain.
Ce qui finalement détermina Leger à accepter de comparaître, c’est que le Juge Bracq, décidément allergique aux pressions, allait, si Leger ne se rendait pas à la convocation, « prendre des mesures pour PERQUISITIONNER AU QUAI D’ORSAY en vue d’établir d’où et comment toutes ces pièces s’étaient envolées[146] ». À éviter absolument.
Thursday 26 June, voici Leger devant le Juge. Comme l’écrira L’Action française non sans humour : « Leger se couvre de son chef[147] ».
Interrogatoire de M. Léger
25 June 1930
L’inculpé déclare :
Je n’ai pas besoin d’avocat et je vous ferai la déclaration suivante :
Sans vouloir examiner les allégations de M. de Noblet que je n’entends même pas qualifier, je déclare n’avoir jamais eu à suivre la procédure instituée au ministère des Affaires étrangères au sujet de l’affaire Horan, Deleplanque et de Noblet, qu’en qualité officielle de Chef de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères, agissant sur son ordre et sous son contrôle direct pour la transmission ou l’exécution de ses instructions. Je ne saurais donc répondre personnellement d’actes administratifs accomplis sous la seule autorité du Ministre dont je relève et qui a, en pleine connaissance de cause, constamment et entièrement approuvé toute mon activité professionnelle dans cette affaire.
ALEXIS LÉGER
L’Action française, 7 août 1930.
L’indépendance d’un Juge d’instruction a ses limites. Il a bien fallu que, sur ordre du Procureur (lui-même sous les ordres du Ministre de la Justice, Raoul Péret[148]), Bracq obtempère :
Le procureur a prié le juge d’avoir à prendre la meilleure de ses plumes serves pour conclure au non-lieu. Ce qui ne pouvait pas ne pas être fait.
L’Action française, 16 July 1930.
Le non-lieu d’Aristide[149]
L’instruction a donc bel et bien été arrêtée et les plaintes rejetées. Le Juge Bracq « a signé une ordonnance de non-lieu en faveur de M. Léger qui n’avait déposé sa plainte contre M. de Noblet d’Anglure que sur l’ordre de ses chefs[150] ».
Les réactions de L’Action française and Figaro, quand la nouvelle du non-lieu aura été publiée, Saturday 12 July, ont bien sûr été vives. Le journal de Maurras et Daudet dénonce une fois de plus « un scandale sans précédent », « un coup d’État judiciaire », Le Figaro « une violation grave du pouvoir judiciaire[151] ».
Les autres journaux ont, soit donné l’information sans commentaire aucun (c’est la majorité), soit en ont rendu compte sous des formes proches qui font penser que des éléments de langage leur ont été fournis.
Il n’a fait qu’obéir aux ordres de ses chefs[152].
Il a agi par ordre[153].
Il a toujours agi conformément aux ordres qu’il avait reçus du ministère[154].
Le ministère des Affaires étrangères a, ainsi que l’a établi l’enquête, donné l’ordre à M. Léger d’agir comme il l’a fait[155].
Le Ministre a couvert son subordonné et déclaré qu’il avait agi par ordre[156].
Le Ministre ayant entièrement couvert son subordonné et déclaré qu’il avait uniquement selon ses ordres, Mrs. Brack, juge d’instruction, vient de clore son information par une ordonnance de non-lieu[157].
Il n’est guère que Le Populaire pour émettre, avec un « paraît-il » fort discret il est vrai, un soupçon de réserve :
En ce qui concerne M. Léger, un non-lieu a été rendu par M. Brack, juge d’instruction, le Ministre des Affaires étrangères ayant paraît-il, donné l’ordre d’agir comme il l’a fait[158].
Au fil des jours, quelques journaux plus modérés que L’Action française and Le Figaro feront une place à l’affaire, ce dont Maurras se réjouira fort. Ils émettent eux aussi des réserves quant à sa gestion par Briand et Leger. Ce sont par exemple Le Journal, Cross, Le Populaire and Le Journal des Débats.
Tel qu’en lui-même, Noblet a réagi sans attendre. Dès le 13 July, L’Action française avance avant tout le monde que Noblet projetterait de déposer une « une plainte nouvelle contre M. Briand en personne ». Le Figaro le répète le 14. La Liberté du même jour le pense également du fait que « l’ordonnance de M. Briand est difficilement soutenable au point de vue juridique ». L’Action française and Le Figaro, the 16 and 17 July, annoncent que la plainte contre Briand a effectivement été déposée.
Encore une fois, les autres journaux ne se saisissent pas vraiment de l’affaire, celle-ci, malgré des rappels périodiques de L’Action française, semble intéresser de moins en moins … n’étaient les initiatives de Noblet.
Noblet saisit la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel (20 July 1930)
Celui-ci va en effet, après avoir déposé plainte contre Briand, ouvrir un nouveau front en se tournant vers la Chambre des mises en accusation[159] pour faire invalider « le non-lieu par lequel M Briand a réussi à couvrir son Léger [sic] ». Son pourvoi est annoncé comme imminent dans L’Action française the 13 juillet et annoncé comme déposé une semaine plus tard, the 20. Chaque fois, Le Figaro redonne l’information le lendemain.
Ce même dimanche 20 July, une note non signée (« On nous communique la note suivante. ») est publiée dans Le Figaro, L’Ami du Peuple et le lendemain dans Le Journal des Débats. L’Action française est le seul journal à la présenter comme ayant été « communiquée à la presse par M. de Noblet ».
L’affaire de Noblet
On nous communique la note suivante :
« Dès qu’il a eu communication de la note du juge, Mrs. de Noblet s’est pourvu contre l’ordonnance de non-lieu sans instruction rendue sur sa plainte en dénonciation calomnieuse.
« Cette plainte, développée par des notes signées de lui remises au juge d’instruction, visait nominalement et personnellement : 1° M. A. Léger ; 2° le Ministre des Affaires étrangères, le refus de M. Léger de s’expliquer sur les faits dont il avait été inculpé, et la lettre du Ministre au Garde des Sceaux, d’ailleurs non versée au dossier, par laquelle, Mrs. Briand déclarait couvrir son subordonné, devait entraîner l’inculpation immédiate du Ministre dès la clôture de la session parlementaire. En vertu de l’article 12 (paragraphe 2) de la loi constitutionnelle de 1875, tout Ministre est responsable civilement et pénalement de ses actes devant les tribunaux de droit commun. »
Mrs. le substitut Gaget aurait été chargé par M. Dodat-Guigue, procureur général, de rapporter l’affaire.
Journal des Débats, 20 July 1930.
L’Action française est le seul journal à citer intégralement cette note, y compris sa dernière phrase que les autres n’ont pas reproduite :
Il est impossible que la Chambre des mises en accusation confirme le déni de justice qui a été imposé au juge d’instruction.
L’Action française, 20 July 1930.
À la réflexion, Wednesday, 23, le journal émet quelques doutes quant à ce que sera la décision de la Chambre des mises en accusation :
Si M. Briand n’était pas au-dessus de la justice, il devrait être immédiatement inculpé. Peut-être le sera-t-il dans quelques jours si la Chambre des mises en accusation n’ose pas descendre les derniers degrés de la servilité.
L’Action française, 23 July 1930.
La Chambre s’est réunie dès le vendredi 25[160]. L’Action française, de tous les journaux le plus assidu à suivre l’affaire, annonce le dimanche 27 juillet que « l’arrêt est attendu d’un jour à l’autre ». Cette hâte est suspecte aux yeux de L’Action française, tant elle est inhabituelle. En réalité, la décision va se faire attendre mais peu importe, le même journal en tire argument en ce que ce délai révèlerait l’embarras de la Chambre : difficile pour elle de rendre la justice en toute indépendance au lieu de continuer à « lécher l’ours » :
La Chambre des Mises continue à délibérer sur le non-lieu briandinien de M. Alexis Leger, et elle lèche l’ours dans un si grand mystère qu’il est impossible d’en rien savoir.
L’Action française, mercredi 27 July 1930.
Nous concevons la lenteur de la Chambre des Mises. L’affaire qu’elle « juge » est en joli état !
L’Action française, Friday 29 July 1930.
La Chambre des mises en accusation confirme les deux non-lieux mais Faux-Pas-Bidet et Leger demeurent menacés de poursuites
(29 July 1930)
L’information tombe enfin, Tuesday 29 July 1930. Les deux plaintes sont rejetées : la plainte contre Léger, pour dénonciation calomnieuse, parce qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres, la plainte contre le commissaire, parce que « la Première Chambre de la Cour est seule compétente en raison des fonctions de M. Faux-Pas-Bidet ».
La plupart des journaux en font état sans commentaire aucun mais c’est peu de dire que certains, au contraire, réagissent sans modération :
S’il y avait encore en France quelques grammes du sentiment national, dans trois semaines au plus M. Briand recevrait à la caponnière[161] de Vincennes, sous forme de douze balles, le salaire des crimes qu’il vient d’avouer et de ceux qu’il n’a pas encore confessés.
Le Provincial, Fontainebleau,
cité par L’Action française, Friday 29 July 1930[162].
Protestation véhémente de L’Action française :
La Chambre des Mises a préféré servir que dire le droit. Couvrant la forfaiture de Briand rendue évidente par le délit de dénonciation calomnieuse, elle a confirmé le non-lieu. Briand et Léger sont hors de cause, …. quant au présent.
L’Action française, Saturday 30 July 1930.
« Quant au présent » ? Pourquoi cette réserve ?
Parce que d’abord, Briand demeure sous la menace de la plainte que Noblet a déposée contre lui le 13 July (il n’a pas encore été statué sur elle).
Parce que, d’autre part, rien n’empêche que la plainte contre Faux-Pas-Bidet, pour séquestration arbitraire, plainte pour laquelle la Chambre des mises en accusation s’est dite incompétente, ne soit reprise par une autre instance qui, elle, serait compétente. « Le Premier Président de la Cour décidera s’il y a lieu de saisir cette juridiction ». Mais celui-ci ne l’a pas décidé.
Et même, s’agissant de Leger… La Chambre des mises en accusation, étudiant le cas du commissaire Faux-Pas-Bidet, a mis en évidence l’implication de Leger dans ce volet de l’affaire. C’est bien ce dernier qui a remis à Faux-Pas-Bidet le dossier de l’affaire accablant Noblet. Et qui d’autre que Leger, en accord avec la Police, a fait en sorte que Noblet se soit rendu en toute innocence à la Préfecture de Police au prétexte de « contribuer à l’enquête[163] » ?
La Chambre des mises en accusation a surtout pris en compte le fait qu’au début de son interrogatoire, quand le commissaire commença à le maltraiter,
[Noblet] demanda à téléphoner au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères, à M. Léger, on lui répondit que c’était ce dernier qui avait donné les ordres nécessaires pour son arrestation et que sa mise en liberté n’aurait lieu que s’il se décidait à donner une explication conforme aux vœux du ministère.
Army, si effectivement une suite était donnée à la plainte pour séquestration arbitraire, pourrait donc être inquiété pour complicité.
Il appartiendra au Premier Président de décider s’il y a lieu de poursuivre, de désigner un Conseiller rapporteur et de déférer devant la Première Chambre de la Cour M. le commissaire de police Faux-Pasbidet [sic] and, comme complice, Mrs. Léger.
Le Figaro, Saturday 30 July 1930.
Quelques journaux seulement osent employer le mot à propos de Leger, L’Action française bien sûr, Le Figaro, but also Le Journal des Débats and L’Avenir. La plupart sont manifestement réticents à impliquer Leger, soit qu’ils évoquent le fait qu’il puisse être poursuivi mais sans employer le mot qui fâche[164], soit que carrément, ils n’évoquent pas cette possibilité à son sujet comme si elle ne concernait que Faux-Pas-Bidet[165].
L’Action française ne croit pas que l’enquête soit reprise.
Léger reste exposé à un mince risque, purement théorique. Tout cela est réglé comme une partie de musique dont la dernière note sera de non-informer ou, au pis-aller, un pompeux non-lieu rendu avec les augustes solennités de la Cour.
L’Action française, Saturday 30 July 1930.
À moins que Noblet, comme plusieurs fois déjà, continue à se battre, malgré la manœuvre de ces « vieux roués de la Chambre des Mises [that] ont feint d’accorder une satisfaction à M. de Noblet d’Anglure » : ils n’auraient évoqué d’éventuelles poursuites contre Leger, pour complicité, que dans l’espoir que cela le calme.
« Satisfaction dérisoire ! », affirme le journal, « Personne ne s’y laissera prendre[166] ». En réalité, and : la plainte de Noblet contre Briand, déposée le 13 July, n’aboutira pas, aucun Juge ne sera chargé de l’instruire, on n’en entendra plus parler. Quant à la plainte pour séquestration arbitraire, qui visait Faux-Pas-Bidet et maintenant pourrait viser Leger, il dépendait du Premier Président de la Première Chambre de la Cour d’appel que cette juridiction en soit saisie ou non : le Président Eugène Dreyfus n’en a pas décidé ainsi.
While, tout cela, les contemporains l’apprendront plus tard mais pour l’heure, Briand, Faux-Pas-Bidet et Leger ont des raisons de s’inquiéter.
Commission d’enquête parlementaire
Car l’affaire est loin d’être close. Le Conseil d’État, une seconde fois saisi par Noblet en janvier 1930, ne s’est pas encore prononcé. Ni la Commission d’enquête parlementaire vers laquelle Noblet s’était tourné peu auparavant, the 20 November 1929. Des mois passent sans qu’on sache si elle a commencé à s’en occuper ni a fortiori quand elle prendra et publiera sa décision.
Personne n’en parle dans la presse. Seul Le Journal des Débats, à l’occasion de la fermeture inattendue de la session parlementaire, the 14 July 1930, rappelle son importance :
Le congé donné aux Chambres a délivré M. Briand du cauchemar de toute interpellation sur l’affaire de M. de Noblet.
Ce ne serait pas la première fois que Briand aurait manœuvré pour retarder une échéance désagréable.
À la rentrée parlementaire, the 1er th, l’affaire n’a toujours pas été mise à l’ordre du jour. D’où, après encore cinq mois d’attente, une nouvelle initiative de Noblet : il envoie à certains journaux copie de la longue lettre qu’il a adressée au Président de la Commission d’enquête parlementaire, Louis Marin[167].
Une lettre de M. de Noblet à M. Louis Marin
Mrs. de Noblet, qui fut, on s’en souvient, inculpé dans l’affaire de l’accord naval franco-anglais, vient d’adresser une lettre au Président de la Commission pour lui demander d’évoquer l’affaire de la divulgation du document.
L’Ami du Peuple,18 February 1931.
La lettre est évoquée le 18 February 1931 et partiellement citée dans L’Ami du Peuple and Le Figaro, in L’Action française du lendemain, résumée dans Cross and Le Journal des Débats, mais presque intégralement reproduite dans L’Action française from June 20.
Elle est trop longue pour être reproduite ici[168]. Elle fait posément l’historique de l’affaire depuis le début et c’est accablant pour Briand et surtout Leger, nommé à de multiples reprises. Comme l’écrira L’Action française, Noblet leur « a taillé d’assez dures croupières[169] ».
C’est par cette lettre qu’on apprend ce que demande Noblet à la Commission d’enquête parlementaire :
Faire la lumière sur les actes de corruption et de trafic d’influence qui ont ruiné l’accord franco-anglais aussi bien que sur les interventions politiques qui ont permis de forger de toutes pièces une accusation d’espionnage et qui depuis lors ont sans cesse aidé et protégé les coupables.
Le Figaro, 18 February 1931, L’Action française and
Cross, the 19, Journal des Débats, the 20.
Il n’est guère que l’hebdomadaire satirique Cyrano pour s’étonner que,
alors que tout semblait s’arranger, Mrs. de Noblet [ait] pri[s] la mouche et amorc[it is] contre le Cabinet du Ministre des Affaires étrangères une campagne qui ne résiste pas à l’examen impartial[170].
L’absence, dans la plupart des journaux, de tout commentaire dit assez leur embarras[171].
La position de L’Action française au contraire est des plus claires : « Louis Marin et les trente-deux autres membres de la Commission d’enquête […] se feront un devoir d’opposer au coup manqué de M. Briand la riposte de l’énergie et du bon sens[172] ».
 Louis Marin, député, Président de la Commission d’enquête parlementaire
Louis Marin, député, Président de la Commission d’enquête parlementaire
consacrée à l’affaire Oustric.
Selon Le Figaro, la Commission d’enquête qui se voit ici « ouvertement bafouée par M. Briand […] serait décidée à ne pas se laisser ridiculiser et entreprendrait très vite l’examen de l’affaire. Mais l’énergie de M. Marin sera-t-elle à la hauteur de sa probité[173] ? ».
« La Commission se réunit ce matin » lit-on le 30 avril dans L’Ami du Peuple « mais c’est pour s’ajourner au 4 mai ». Pendant plusieurs mois, certains vont continuer d’espérer qu’elle statue enfin sur l’affaire, especially L’Ami du Peuple from June 16 June 1931, cité le jour même par L’Action française and Le Figaro.
L’affaire ne sera jamais inscrite à l’ordre du jour de la Commission. À cela, une explication, la même qui avait fait que le Conseil d’État n’avait pas donné suite au premier pourvoi de Noblet : l’affaire a pris, fin avril, à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, un tour nouveau : après un premier décret qui avait suspendu Noblet pour une durée de deux ans, Briand a signé un nouveau décret qui est autrement plus grave. Il aurait fallu que, sur de nouvelles bases, Noblet et son avocat présentent à la Commission un nouveau dossier. Ils ne l’ont pas fait, Louis Marin ne sera pas saisi de leur part d’une nouvelle demande d’enquête.
Noblet continue d’espérer que le Conseil d’État lui donne satisfaction, mais pour l’immédiat, il va falloir réagir à l’initiative prise à son encontre par Briand sur le plan administratif.
Nouvelle convocation de Noblet en Conseil de discipline (avril 1931)
Noblet avait, in August 1929, alors qu’il avait été placé en disponibilité, demandé à reprendre ses fonctions. Le Conseil de discipline censé en décider s’est tenu en novembre, Noblet a été par décret suspendu pour deux ans. Cette fois, en avril 1931, c’est le Ministère qui a décidé de faire comparaître Noblet devant un nouveau Conseil de discipline. Les reproches qu’on lui peut faire sont autrement plus graves. L’Administration ne pouvait laisser passer sans réagir les deux plaintes que Noblet avait déposées, en novembre 1929, qu’il avait confirmées en avril 1930, ni la nouvelle plainte contre Briand déposée le 13 mai 1930, doublée de la plainte contre Leger qu’avait envisagée la Chambre des mises en accusation fin juillet de la même année, ni surtout, son recours à une Commission parlementaire. Sans compter ses courriers à la presse.
Le lundi 20 avril 1931, Noblet a donc reçu, du Secrétaire général du Ministère, une convocation à comparaître le mercredi 22 devant un Conseil de discipline. Noblet adressera aussitôt sa réponse directement au Ministre, comme plusieurs fois déjà. La lettre reçue et sa réponse ont-elles été par lui adressées à de nombreux journaux ? À notre connaissance, L’Action française and Le Figaro sont les seuls à les avoir reproduites :
Le Ministre des Affaires Étrangères
à M. de Noblet d’Anglure, secrétaire d’Ambassade en non-activité
J’ai l’honneur de vous faire savoir que j’ai décidé de vous faire comparaître devant un Conseil de discipline. Vous aurez à répondre, devant ce Conseil, de faits constituant des manquements à vos obligations professionnelles et une atteinte grave à la discipline.
Signé : BERTHELOT
Mrs. de Noblet a répondu :
21 avril [1931]
Monsieur le Ministre,
Je reçois la lettre par laquelle vous m’invitez à comparaître demain à 3 . 30 devant un Conseil de discipline.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que je ne me rendrai pas à cette convocation. Placé en non-activité de service pendant deux ans à la suite d’un premier Conseil de discipline devant lequel vous m’aviez traduit le 14 November 1928, en qualifiant d’indiscipline le seul fait de vous avoir adressé un rapport dont vous n’osiez pas discuter le bien-fondé, je n’ai eu depuis cette époque aucune relation avec ce département. Je n’ai reçu aucun ordre, aucune instruction et n’ai eu aucun contact d’aucune sorte avec l’Administration. Je n’ai donc pu ni « manquer à mes devoirs professionnels », ni « attenter gravement à la discipline ».
Mes seules actions ont consisté à SAISIR LA JUSTICE devant laquelle M. Léger, Chef de votre Cabinet, a refusé de s’expliquer et à laquelle vous avez imposé l’arrêt des opérations judiciaires : d’autre part à « saisir le Parlement » et en particulier la Chambre d’enquête de la Chambre [des députés] en communiquant des mémoires précédemment remis à la justice par mon défenseur.
Je n’ai fait qu’accomplir mon devoir et exercer mes droits de citoyen en m’adressant à la juridiction du droit commun et au Parlement. Le Ministre des Affaires étrangères n’est ni au-dessus des lois ni au-dessus des représentants de la nation.
La décision que vous avez prise de me frapper par voie disciplinaire, faute de pouvoir répondre aux documents accablants produits récemment, est un acte qui n’a pas d’exemple. Et le seul fait que la Cour de cassation et la Commission d’enquête vont être appelées à se prononcer, suffirait à m’interdire de me présenter devant ceux-là même sur qui pèsent en ce moment les plus graves accusations.
JEAN de NOBLET
diplômé des sciences politiques,
licencié ès lettres, licencié en droit,
Secrétaire d’ambassade
L’Action française and Le Figaro, 27 avril 1931,
L’Écho de Paris, 28 avril 1931.
À noter que Noblet, comme beaucoup d’autres, nomme « Cour de cassation » ce qui avait jusqu’ici été appelé « Chambre des mises en accusation ».
On apprendra plus tard une raison de son refus de se rendre à la convocation : il « n’a pas été à même de prendre communication de son dossier [et n’a] connu les griefs articulés contre lui que lorsqu’il fut invité à comparaître devant un Conseil de discipline[174] ». Il avait reçu sa convocation deux jours seulement avant la tenue du Conseil.
Noblet révoqué (27 avril 1929)
Le Conseil de discipline a donc siégé sans lui le mercredi 22 avril. Il transmettra son avis au Ministre le samedi 25, celui-ci le validera et en tirera les conséquences le lundi 27 : par décret Noblet est révoqué.
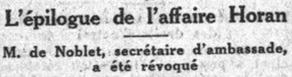 Le Petit Parisien, 30 avril 1931.
Le Petit Parisien, 30 avril 1931.
Le Petit Parisien est très optimiste quand il affirme en titre que la révocation de Noblet marque « L’épilogue de l’affaire Horan » comme si elle était terminée, il méconnaît la pugnacité du jeune diplomate et oublie que, d’une part, le Conseil d’État, saisi par lui, n’a pas encore statué, et que d’autre part, Noblet a saisi la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel. Le journal se trompe encore quand, comme d’autres, il évoque Horan alors que
la mesure d’exclusion définitive […] a été motivée non tant par sa participation à l’affaire Horan que par l’attitude qu’il avait adoptée par la suite[175].
Cette « attitude » n’est généralement pas explicitée ni discutée, ce qui suggère, de la part des journaux, comme une approbation de la sanction qui frappe Noblet. L’Action française, Le Figaro, L’Ami du Peuple, au contraire le félicitent pour sa ténacité et, 5 lithographies de Hélio Cabral, The binding. F. Ax, ex. No. 47 Foundation for Saint-John Perse] [Portuguese translation, Brazil]. Paris-Midi, considèrent les membres du Conseil de discipline comme des « exécuteurs ». Un seul journal est explicitement défavorable à Noblet, L’Œil de Paris :
Victime, en somme, du projet de désarmement naval, Mrs. de Noblet a été finalement révoqué. Il faut reconnaître, que même innocent, il a tout fait pour arriver à cette sanction.
Des amis lui avaient conseillé de faire le mort : « Reste tranquille, fais-toi oublier. Tu es mis en disponibilité pour un temps, mais ce laps de temps écoulé, on te réintègrera, et sinon dans les cadres actifs, du moins au Protocole… On te trouvera un bon petit coin… Mais sois sage, voyons ! ».
Mais M. de Noblet n’a pas été sage : il a crié par-dessus les toits son innocence, il a réclamé des juges, il a fait, à droite et à gauche, de l’esclandre… Bref, ce jeune homme s’est tellement remué qu’il a fini par lasser tout le monde.
Conseil de discipline : révocation.
L’Œil de Paris, 9 mai 1931.
Quelques journaux, especially Time and Le Petit Journal, justifient explicitement la sanction en évoquant les « polémiques pour le moins regrettables » qu’a déclenchées le « fonctionnaire rébarbatif ».
Shortly, certains croiront pouvoir affirmer que Noblet a abandonné la partie. Sous le titre « Changement de carrière », L’Œil de Paris évoque la reconversion de Noblet dans le commerce du vin (une partie de sa famille réside à Gaillac) ou des antiquités :
Mrs. de Noblet d’Anglure n’est plus de la Carrière. Il vend aujourd’hui des antiquités. Mon Dieu ! ça, ou placer du vin… Il paraît d’ailleurs qu’il ne regrette pas le Quai… Les vieilles commodes se vendent fort bien, surtout lorsqu’on porte un si beau nom.
L’Œil de Paris, 9 mai 1931.
Simple rumeur malveillante. Noblet demeure lui-même et ne tardera pas à contrattaquer par une nouvelle requête devant le Conseil d’État.
Nouvelle requête de Noblet devant le Conseil d’État (1er July 1931)
L’information n’est dans quelques journaux qu’à partir du 11. Noblet avait une première fois saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de sa suspension, il le saisit maintenant « aux fins d’annulation contre cette décision de révocation » et « excès de pouvoir[176] ».
Dans les mois et même les années qui suivent, il ne sera plus question de cette nouvelle requête dans la presse, pas même pour s’étonner que le Conseil n’ait pas encore statué. Il ne le fera qu’en 1934…
Chambre des mises en accusation, suite et fin (November 1931)
Il faudra cinq mois, depuis juillet 1931, pour que la Chambre des Mises statue sur son cas, cinq mois qui auront été particulièrement calmes sur le front de l’affaire, celle-ci n’étant nulle part évoquée. Le dimanche 14 November, il en est enfin à nouveau question : les non-lieux qui avaient été prononcés par le Juge Bracq au sujet des plaintes de Noblet contre Leger et Faux-Pas-Bidet sont confirmés.
Pour quel motif ?
Noblet contestait sa révocation au motif que l’instruction du Juge Bracq se caractériserait par un « refus d’informer » : la plainte visant Faux-Pas-Bidet portait sur sa responsabilité dans la « séquestration arbitraire » de Noblet, c’est ce sur quoi on devait « informer » pour motiver son non-lieu, or cela n’a pas été fait au motif que le policier relevait d’une autre instance. Une instance que le Juge a d’ailleurs indiquée dans son ordonnance.
Il n’y a donc pas eu refus a priori d’informer, la décision d’interrompre l’instruction s’est imposée au Juge, lui n’a rien refusé du tout. La presse en rend compte en ces termes :
Il n’y a pas eu refus d’affirmer [sic] de la part du Premier Président [car] celui-ci avait désigné un conseil afin de procéder à l’examen des faits[177].
S’agissant de Leger, le non-lieu pour « dénonciation calomnieuse » n’est même pas justifié par la Cour de cassation, elle admet donc tacitement qu’on n’est pas coupable quand on commet un délit sur ordre. D’où le rejet du pourvoi contre ce non-lieu. Il est certes apparu que Leger pouvait être poursuivi pour complicité avec Faux-Pas-Binet dans la « séquestration arbitraire » de Noblet mais le Juge Bracq n’avait pas eu mission d’enquêter sur ce point en ce qui concerne Leger, le « ministère public » ne le lui demandait pas, il n’y a donc pas eu là non plus de refus d’informer de la part du Juge. Le non-lieu est donc confirmé,
parce que le ministère public ne s’était pas pourvu contre l’arrêt de non-lieu, l’action publique ne pouvant revivre par l’intervention de la partie civile[178].
« Prétexte » tonne L’Action française[179].
Tout ceci est bien compliqué et devient carrément incompréhensible quand, dans plusieurs articles consacrés à l’affaire, comme on a vu, un lapsus fâcheux a remplacé « refus d’informer » par « refus d’affirmer ».
Libre à Leger de penser qu’il en a fini avec cette affaire mais celle-ci a déjà tant de fois rebondi dans le passé ! D’autant que le commentaire de L’Action française, the 17 November, résonne comme une menace : le journal, contrecarrant les efforts de la Cour de cassation pour étouffer l’affaire, affirme sa détermination à vouloir « lever le voile sur les manœuvres abominables qui sont le courant de notre ministère des Affaires étrangères ».
Ce faisant, il sera bien seul. Manifestement, les journalistes et les lecteurs sont las de l’affaire, pendant les deux mois qui suivent, de loin en loin, la presse y fait encore référence mais sans développer.
Noblet pour sa part semble être passé à autre chose. Non plus le commerce de vin ou d’antiquités cette fois, Cyrano annonce en effet le 3 avril 1931 que le « héros involontaire de l’affaire Horan-Berthelot » va se présenter aux élections législatives. D’ailleurs, selon Aux Écoutes from June 23 du même mois, Leger lui-même, qui « vit actuellement dans une retraite méditative », a lui aussi « songé à être candidat, en Loire-Inférieure, dans l’ancienne circonscription de son patron ». Noblet se présentera effectivement aux élections, à Gaillac (battu au second tour). For Leger, la rumeur n’était pas fondée, ou bien il a changé d’avis.
Résultat, dans la presse, Leger n’est plus systématiquement nommé et quand il l’est et que sont rappelées les mêmes accusations contre lui[180], aucune dynamique ne s’enclenche. Contrairement à d’autres périodes, aucun journal ne reprend plus les articles de L’Action française, pas même Le Figaro. Manifestement, Léon Daudet et Charles Maurras mènent un combat d’arrière-garde – ou mieux, évoquent pour mémoire, un combat d’un autre temps – quand ils répètent, the 25 th 1932, que « les scandales Hearst, Horan, de Noblet d’Anglure, dans lesquels a trempé le commissaire crapuleux Faux-Pas-Bidet, ont suffisamment montré la sentine qu’était devenu le Quai d’Orsay depuis l’inamovibilité de Briand ».
De l’affaire il sera désormais de moins en moins question dans la presse. Horan et Hearst sont redevenus fréquentables. The 29 avril 1933, Le Journal évoque un entretien accordé par Édouard Herriot à Horan sans que personne ne s’en émeuve. De même quand Raymond Recouly, in Gringoire, the 12 mai suivant, en visite « Chez Hearst, prince de Californie » (tel est le titre de l’article), dit tout le bien qu’il pense de son hôte.
Le Conseil d’État rejette l’ultime requête de Noblet (March 1934)
Il aura fallu trois ans au Conseil d’État, from 27 avril 1931, pour se décider. Dans son pourvoi, Noblet se plaignait d’avoir été trop tardivement informé des reproches qu’on lui faisait. Le Conseil d’État estime cette plainte injustifiée.
Le Conseil d’État a rejeté la requête de M. Noblet d’Anglure qui a eu connaissance en temps utile des faits qui lui étaient reprochés[181].
Quant au fond de l’affaire, Excelsior l’écrit tout net, on est loin d’une affaire d’espionnage :
Ce fonctionnaire […] a été révoqué pour avoir écrit une lettre impertinente à M. Aristide Briand, alors Ministre des Affaires étrangères[182].
« Impertinente » la lettre de Noblet ? Morning écrit « injurieuse[183] » alors qu’en 1931, à l’époque où Briand la reçut, la presse évoquait seulement quelques « écarts de plume[184] » et des « termes assez vifs[185] ». Ce contre quoi Noblet continue de protester, affirmant au contraire s’y être exprimé « dans les termes les plus déférents » et s’être toujours adressé à Briand « avec le plus grand respect[186] », reconnaissant tout au plus avoir écrit sa lettre « avec toute la chaleur d’un honnête homme qui souffrait atrocement d’un injuste soupçon[187] ».
La lettre n’ayant pas été publiée, les contemporains ont été dans l’incapacité d’en juger[188].
En dehors d’Excelsior and Morning, rares sont les journaux qui évoquent le rejet du pourvoi, pas même L’Action française. C’est que nous sommes six ans après le début de l’affaire. Après tant d’annonces de rebondissements et de rebondissements avortés, le sujet n’intéresse plus, d’autant qu’en l’occurrence, le rejet du pourvoi n’est pas une surprise.
Shortly, Léon Daudet n’en parle plus, au passé, que pour dire sa déception de n’avoir pas réussi en son temps à déclencher un mouvement d’opinion assez puissant pour débarrasser le pays de Briand et Berthelot (que longtemps L’Action française a attaqué plus que Leger). Sa lutte est désormais sans objet après la maladie puis la mort de Briand, the 7 March 1932, la retraite de Berthelot en 1932, sa mise en disponibilité en 1933 puis sa mort en 1934.
L’affaire Horan n’aura finalement été selon lui qu’un « scandalet » au regard d’autres scandales actuels.
En mai 1935 seulement, une dernière fois, il en sera question dans Time dans un long article où le journal revient sur ce qui a amené, un an plus tôt, le Conseil d’État, à ne pas donner satisfaction à Noblet. Il révèle un motif de plainte de sa part qui nous était inconnu et montre comme a été âpre le combat qui a opposé Noblet à ses juges.
Noblet a contesté la composition irrégulière du Conseil de discipline qui l’a sanctionné. Leger n’est pas nommé mais n’en est pas moins au cœur du débat.
L’avocat de Noblet avait en effet retrouvé un texte organique datant de 1820 et stipulant que le Conseil de discipline du Ministère devait être présidé par le Directeur des Affaires politiques et commerciales. The 12 November 1929, tel avait été le cas, Corbin était bien ce Directeur quand il a présidé le Conseil, or le dernier Conseil de discipline, celui qui a révoqué Noblet en avril 1931, n’a pas été présidé par le Directeur mais par son adjoint, Laboulaye.
Le Ministère avait prévu que Noblet et son avocat pourraient en tirer argument, aussi avait-il pris le 15 avril 1931, soit quelques jours avant la comparution de Noblet devant le Conseil de discipline, un premier décret qui rendait licite le remplacement du Directeur par son adjoint, avant, dans un second décret, de fixer la composition du Conseil de discipline suivant la règle nouvelle, c’est-à-dire le Directeur adjoint comme Président.
Riposte de Noblet : le second décret, celui qui nomme les membres du Conseil, pris en application du premier décret, n’est pas exécutoire car pris prématurément :
Mrs. de Noblet d’Anglure [fit] remarquer que, suivant les principes déterminés par un décret bien connu du 5 November 1820, le décret du 15 avril, paru à l’Officiel from June 19 avril, ne devenait exécutoire que le 21 du même mois. Il en résultait, suivant lui, que l’arrêté ministériel du 15 avril, fixant la composition du Conseil, était prématuré et n’aurait pu régulièrement être signé qu’après le 21 avril. Il y aurait donc eu un vice de forme entachant de nullité toute la procédure.
Réponse du Ministère : pas du tout !
Le commissaire du gouvernement, Mrs. Georges Dayras, s’est élevé contre cette interprétation. Il a fait remarquer que c’est à la date où se réunit le Conseil de discipline qu’il faut se placer pour apprécier la régularité de sa composition. L’existence légale du décret du 15 avril était antérieure à la date à laquelle il devenait exécutoire et, dès le 15 avril, l’Administration devait en tenir compte pour fixer la composition du Conseil de discipline. L’arrêté ministériel du 15 avril ne peut donc pas être incriminé.
Les autres membres ont partagé cette analyse.
En quoi tout ceci nous importe-t-il ? En ce que, avec ses décrets, l’Administration a voulu éviter que le Directeur des Affaires politiques et commerciales préside le Conseil. The 12 November 1929, c’était Corbin, pas de problème, and, from 25 du même mois, Leger lui avait succédé à ce poste. Étant donné le degré d’implication de Leger dans l’affaire, s’il avait personnellement présidé le Conseil, toute décision du Conseil de discipline aurait inéluctablement été contestée du fait que le Président, Army, aurait été juge et partie.
Le commissaire du gouvernement, sans nommer Leger, a reconnu que tel était le but de la manœuvre.
Le commissaire du gouvernement a d’ailleurs tenu à faire observer que le décret du 15 avril, substituant le Directeur adjoint au Directeur, constituait de la part de l’Administration supérieure un acte de véritable partialité[189]. Le Directeur des affaires politiques se trouvait être en effet précisément le fonctionnaire contre lequel M. de Noblet d’Anglure avait émis l’accusation inexacte à raison de laquelle il était cité devant le Conseil de discipline. La présence de ce haut fonctionnaire au Conseil de discipline était donc contre-indiquée.
Time, 26 mai 1935.
Le remplacement de Leger par Laboulaye n’avait été relevé à l’époque, in 1931, par personne, il n’est guère, trois ans plus tard, que Le Figaro and L‘Action française pour le dénoncer, le premier, en affirmant que « M. Léger n’a pas osé opérer lui-même, ce sont ses trois collaborateurs immédiats qui se sont chargés d’exécuter ses ukases[190] », le second, en montrant que Leger demeurait le maître du jeu :
Comme il fallait s’y attendre M. de Noblet est révoqué. Les noms des exécuteurs ont été donnés à la presse : Mrs. de Laboulaye, adjoint de M. Léger à la Direction des Affaires politiques, Mrs. Charvériat, adjoint de M. Léger au Cabinet du Ministre, et M. Knight, Directeur du service de presse, service annexe du Cabinet du Ministre.
On assure, au Quay d’Orsay, que M. Knight ne connaît pas M. de Noblet et ne l’a même jamais vu : Mrs. Briand n’en est pas à ce mensonge près !
L’Action française, Paris-Midi, 1er mai 1931.
Tous les efforts de Briand pour que quelqu’un siège à la place de Leger nous importent en ce qu’ils confirment, si on en doutait encore, que l’affaire est bien devenue une affaire personnelle entre Noblet et Leger et a été reconnue comme telle.
Dernières années d’Alexis Leger au Ministère
Après la décision du Conseil d’État en mars 1934, on ne relève plus dans la presse de séries d’articles en rapport avec l’affaire, celle-ci n’est plus abordée que de loin en loin. In 1938, L’Action française évoque encore, comme « conséquences d’agissements philippesques », divers anciens scandales qui avaient éclaté au Quai d’Orsay, « les affaires de Noblet, Hearst, Horan, dont nous avons longuement parlé », mais quel intérêt trouver, en dehors du plaisir de jouer avec les mots et les images, à évoquer « le temps où le maquereau bénit Aristide Briand couvrait ces ignominies de sa nageoire[191] » :
Convoqué chez le juge d’instruction, Briand refusa de se rendre à la convocation : « C’est-il qu’on me prend, zoui vou non, pour de la roupie de sansonnet ! » Le juge, terrorisé, n’insista pas. Offenser de la sorte monsieur Aristide, archiduc de la rue d’Orsay, en boîte au lait et espadrilles, auteur en casquette de la loi de Séparation, vous n’y pensez pas !
Leger demeure certes attaqué, et violemment, dans ce même article comme dans d’autres, mais l’affaire ne pèse plus rien face à d’autres reproches que certains lui adressent maintenant. Nous sommes en 1938. Comert et Massigli, qui désapprouvent les accords de Munich, ont quitté le Quai d’Orsay mais « Léger reste, et avec lui le purin d’antan, le purin de la guerre future[192] ».
Après le rejet de la dernière requête de Noblet devant le Conseil d’État, en mars 1934, l’affaire n’a pas rebondi, sur le plan judiciaire, cette fois elle est objectivement close.
Concernant Noblet, deux décrets vont paraître au Journal officiel, très exactement le 9 September 1939 (ils avaient été pris deux mois plus tôt, the 8 July) dont le premier est susceptible de lui donner enfin satisfaction (et à Leger assurément beaucoup moins) : il est accordé à Noblet ce qu’il avait en vain réclamé dix ans plus tôt, d’être réintégré « dans le cadre des agents de son grade ». Quant à son affectation, le second décret évitera que Leger et lui ne se croisent dans les couloirs du Ministère :
Mrs. de Noblet d’Anglure (Jean-Marie-Étienne), Secrétaire d’ambassade de 3ème classe, a été chargé des fonctions de son grade à l’ambassade de Buenos Aires.
Noblet a en effet été réintégré en application de la loi du 12 July 1937, une loi d’amnistie très large qui concerne des personnes sanctionnées pour toutes sortes de délits. Leger n’est pour rien dans sa réintégration.
Noblet n’a pas hésité à demander à en bénéficier. Ce faisant ne semblait-il pas admettre in fine sa culpabilité ? Noblet ni personne n’a fait ce commentaire. L’heure n’est manifestement plus aux polémiques publiques. Pour autant, sa réintégration n’a pas été une formalité. Il faudra deux ans on l’a dit pour que la loi lui soit enfin appliquée.
Le retard de son avancement, à la suite de sa révocation, n’a pas été automatiquement comblé, manifestement son nom, qu’il soit coupable ou pas, est demeuré attaché à l’affaire et en diverses occasions plusieurs sauront la lui rappeler[193]. On y fait quelquefois seulement allusion :
N’oubliez pas le vicomte [sic] Noblet d’Anglure qui, dans la Carrière, s’est fait une spécialité qui lui valut à son heure, en France, une certaine notoriété et que nos amis américains n’auront certes pas oubliée.
La France nouvelle, Buenos Aires, 26 March 1943.
Pour répondre à de telles attaques, Noblet a comme toujours riposté publiquement et dit et redit sa vérité[194]. Mais les conditions ne sont plus réunies pour que l’affaire rebondisse une fois de plus.
Quant à Leger, depuis qu’il a quitté le Ministère, May 1940, puis l’Europe pour les États-Unis, en juin, il est hors de portée d’une nouvelle initiative de Noblet. Nulle part il n’est question de l’affaire Horan ni de Noblet dans les Complete Works du poète ni, à notre connaissance, dans sa correspondance ou aucun des papiers et documents conservés par la Fondation Saint-John Perse.
Dans la mesure où Noblet, nommé en 1939 à l’ambassade de France en Argentine, a habité Buenos Aires jusqu’en 1943, il a pu y rencontrer Roger Caillois, même si les deux hommes n’étaient pas du même bord[195] : l’ambassade appliquait la politique voulue par Vichy et Caillois avait rejoint le Comité des Français libres local. De plus l’un, Noblet, avait toutes les raisons de se plaindre d’Alexis Leger quand l’autre, Caillois, disait partout son admiration pour Saint-John Perse. Les deux hommes ont pourtant, forcément, dû se rencontrer, la communauté française n’étant pas si nombreuse à Buenos Aires, et ils lisent l’un et l’autre le seul journal local paraissant en français, La France Nouvelle, et y écrivent à l’occasion (Caillois annonce régulièrement la sortie de sa revue The French Letters et y nomme Saint-John Perse). La correspondance de Caillois avec le poète commence justement en 1942, il aurait donc pu évoquer Noblet dans une de ses lettres… Il ne l’a pas fait, sans doute parce qu’il devait savoir que ce rappel de l’affaire aurait été désagréable à son correspondant.
Que nous aura appris l’évocation de cette affaire ?
On savait la proximité de Briand et Leger. Ce dernier – on le lui a reproché – a continué obstinément à croire qu’il était possible de garantir la paix par la signature de pactes internationaux (ce que, dès cette époque, et bien avant Duroselle, on a appelé « pactomanie »). Le discours de Leger en hommage à Briand, prononcé à New York en 1942, a témoigné avec éclat de la force du lien qui l’unissait à Briand.
On savait moins – mais l’affaire Horan en est une illustration indiscutable – que, réciproquement, Briand accordait une confiance absolue à son Chef de Cabinet jusqu’à, dans l’affaire Horan, le couvrir officiellement, par écrit, quand il a été menacé, intervenir auprès des Juges pour que Leger soit entendu comme témoin et non comme accusé, jusqu’à imposer la fin d’une instruction judiciaire et couper court aux éventuelles poursuites qui menaçaient son collaborateur le plus proche.
 Alexis Leger et Aristide Briand
Alexis Leger et Aristide Briand
Briand, depuis si longtemps aux affaires[196], a un tel ascendant sur la plupart des autres ministres qu’on a l’impression qu’il peut tout se permettre, les historiens le savaient, l’affaire Horan nous fait toucher cette réalité du doigt.
Cela importe quant à l’importance que l’affaire a prise pour le diplomate. Sous Briand, quelles que soient les attaques dont il était la cible, Leger n’avait rien à craindre de quiconque. Il n’en a pas été de même du jour où Briand a cessé d’être aux affaires.
Ce que nous révèle l’affaire, c’est qu’ensemble, ils n’ont pas hésité à sacrifier un innocent au nom de la raison d’État laquelle, pour s’imposer, exige qu’on ne soit pas trop regardant sur les moyens employés. L’affaire Horan est née d’une initiative de Briand et Leger qu’il faut bien qualifier de machiavélique : elle a consisté à secrètement faire fuiter un texte et en faire bénéficier un ennemi politique (Hearst) pour brouiller les pistes dans le but de faire avorter un compromis bilatéral et sauver un projet de pacte international dans l’esprit de Locarno. Machiavélique encore l’invention d’un bouc émissaire pour qu’on ne cherche pas d’autre responsable à la fuite originelle. Étant entendu que leur machiavélisme n’est pas forcément à entendre comme une critique ou un reproche pour autant que, comme l’a soutenu Rousseau dans Le Contrat social,
Le Prince de Machiavel est bien le livre des Républicains. En feignant de donner des leçons aux Rois, il en a donné de grandes aux peuples.
Relire Raimond Aron et sa préface au Prince pour s’en convaincre pleinement.
Sartre en a dit quelque chose dans Les Mains sales.
Anyway, difficile d’admirer Leger et Briand pour cela, sauf à être absolument insensible au sort de la victime[197].
Et de l’homme lui-même quand donc sera-t-il question ?
Que nous apprend encore la consultation de la presse et des archives sur ce qu’aura été la vie d’Alexis Leger en tant que diplomate, son état d’esprit, ses sentiments.
Les journaux sont pleins de photos montrant Leger auprès des principaux responsables politiques français et étrangers, Laval ou Daladier, Antony Eden ou Churchill, mais aussi Staline, Mussolini, le Pape au Vatican (et Hitler à Munich). Ils rendent compte des applaudissements qui le saluent, lui et la personnalité qu’il accompagne, ils lui consacrent des articles élogieux à chacune de ses promotions dans la hiérarchie du Ministère et dans l’ordre de la Légion d’honneur, ainsi que lors des dîners qui sont donnés en son honneur.
 Debout dans l’ancienne loge impériale, Pierre Laval et sa fille,
Debout dans l’ancienne loge impériale, Pierre Laval et sa fille,
Mme Litvinov, Charles Alphand et Mme, et Alexis Leger (à l’extrême droite), Morning, 17 mai 1935.
 Cette même photo a paru à la Une de nombreux journaux à partir du 9 janvier 1935 whose Le Populaire, Le Petit Courrier, The Uncompromising, Lyon Républicain, L’Impartial, etc.
Cette même photo a paru à la Une de nombreux journaux à partir du 9 janvier 1935 whose Le Populaire, Le Petit Courrier, The Uncompromising, Lyon Républicain, L’Impartial, etc.
Pendant les huit ans où il fut Secrétaire général du Ministère, from 1933 at 1940, et déjà pendant les huit années précédentes, from 1924 at 1931, alors qu’il n’était que le Chef du Cabinet de Briand, les honneurs, le plaisir d’approcher les grands de ce monde, d’exercer de hautes responsabilités, d’être un acteur de l’Histoire de son pays, tout ceci peut ne pas l’avoir comblé.
L’affaire Horan – devenue pour lui l’affaire Noblet – l’aura tellement occupé, from 1928 et aussi longtemps qu’il fut aux affaires, qu’il ne put durablement l’oublier. L’a-t-elle perturbé ? Sans doute : une partie de la presse l’a si souvent et si brutalement agressé qu’il est exclu que cela ne lui ait pas importé. Comment n’aurait-il pas souffert d’être trop souvent en pleine lumière dans tous les journaux, et souvent maltraité, pendant plusieurs jours de suite en temps de crise, par vagues.
La presse pouvait certes, un temps, le laisser en paix, il était lui dans l’attente – et la crainte – d’une nouvelle initiative de Noblet. Les décisions de tel et tel Juges d’instruction se sont fait quelquefois longuement attendre, de même la décision de la Chambre des mises en accusation, les résultats de l’enquête parlementaire dont Noblet espérait beaucoup, le sort réservé à son pourvoi devant le Conseil d’État.
Les archives révèlent combien l’affaire a continué de l’occuper même dans les périodes de calme sur le plan médiatique.
Par exemple, dans les dernières années où Leger était encore Secrétaire général du Quai d’Orsay, en rapport avec la loi d’amnistie dont a bénéficié Noblet. Promulguée en 1937, l’intéressé n’a été réintégré qu’en 1939. Les journaux ne disent rien des difficultés auxquelles Noblet s’est heurté avant finalement d’obtenir gain de cause. Les archives au contraire en conservent la trace. Le Secrétaire général n’est certes alors nulle part nommé dans les journaux mais il est clair que le Ministère, à l’initiative de Leger, a cherché et donc trouvé des raisons juridiques pour faire obstacle à la réintégration de Noblet.
Difficile d’admettre ce qui, de la part de Leger, relève ici d’un certain acharnement contre Noblet quand, dix ans après le début de l’affaire, il manœuvre encore pour qu’il ne soit pas amnistié. La commission de cinq membres qui avait étudié le cas de Noblet avait pourtant exprimé à l’unanimité un avis favorable à la réintégration de Noblet, le Ministère a soutenu que la loi d’amnistie n’obligeait pas clairement à ce qu’un fonctionnaire amnistié soit réintégré dans son Administration. Cela a été âprement discuté. Il faudra une décision de Daladier pour que l’amnistie de Noblet soit déclarée, et une autre de Georges Bonnet pour qu’elle soit appliquée… On sait que Bonnet n’était pas vraiment ami de Leger.
À la fin des années 1930, Leger aurait pu laisser Noblet retrouver un poste. Briand n’est plus, il a été admis depuis longtemps que les documents publiés aux États-Unis n’avaient rien de vraiment secret et qu’on avait eu tort de parler d’espionnage. Noblet pour sa part n’a cessé de clamer son innocence, elle est admise par tous, et Leger est mieux placé que quiconque pour le savoir…
Mais Noblet a osé s’opposer à lui. Nous le savions pour Maurice Saillet, coupable d’avoir commis un début de biographie sur le poète, nous le découvrons à propos de Noblet : Alexis Leger n’est pas homme à pardonner les offenses.
En tout temps, même par temps calme, Leger a été informé par ses collaborateurs de tout ce qui concernait Noblet. On lui a transmis le double de courriers qui ne lui étaient pas adressés mais pouvaient lui servir contre Noblet. Nombre de pièces du dossier personnel de ce dernier aux Archives diplomatiques portent une mention manuscrite du genre « Transmis à M. Léger tel jour », ou « Rédigé à la demande du Cabinet du Ministre ». Sur un document, une mention signale que le document a été lu par le Ministre à telle date, elle est de la main de Leger dont l’écriture est aisément reconnaissable.
Combien de fois Leger a-t-il abordé le sujet par téléphone sans que les Archives n’en conserve la trace ? Dans une note seulement, un de ses collaborateurs a transcrit les consignes que venait de lui communiquer Leger par téléphone, consignes à transmettre à l’avocat qui représentait le Ministère au Conseil d’État que Noblet venait de saisir, avec indication de ce qui doit être mentionné et ce qui ne doit pas l’être.
Tel correspondant a écrit directement à Leger pour lui rapporter qu’il semblerait que Noblet se soit proposé pour servir d’intermédiaire dans la fourniture d’armes à la Chine. L’idée que tout ce qui peut nuire à Noblet vaut d’être communiqué à Leger semble fort répandue. À aucun moment, même quand la presse n’en parlait plus, Leger n’a pu lâcher l’affaire.
Au moins, sous Briand, Leger se savait protégé. Quand Briand ne sera plus ni Président du conseil ni surtout Ministre des Affaires étrangères (14 janvier 1932), et aura été remplacé par Laval, les charges contre Leger, dans la presse, seront immédiates et particulièrement brutales.
Titre d’un article du Figaro from June 15 janvier 1932 : « La torche à la main ! ». C’est la torche à la main que Laval doit entrer au Quai d’Orsay. L’affaire du document secret est rappelée en passant.
Berthelot, Peycelon[198], Léger, Bargeton[199], ont fait le serment de torpiller Laval par une nouvelle affaire Hearst.
Pour se rendre maîtres de ses leviers de manœuvre, [Laval] devra chasser immédiatement de leur repaire Berthelot, Peycelon, Léger et Bargeton ainsi que leurs créatures et tous les agents que l’Allemagne entretient au Quai d’Orsay.
Nouvelle charge de Léon Daudet dans L’Action française deux jours plus tard :
Si Laval était ce qu’il croit être, il devrait non seulement chasser mais coffrer Berthelot, Peycelon et Léger.
Le plus urgent pour Laval, selon Daudet : « Nettoyer à grande eau, au jet de pompe, son Cabinet du Quai d’Orsay ». On ne parle pas alors de « karcher », celui-ci n’ayant pas encore été inventé.
Tant d’agressivité a certes une origine politique. On sait que, pour sauver la paix, Briand, n’a cessé d’œuvrer au rapprochement avec l’Allemagne et qu’après sa mort, Leger a maintenu ce cap. Sous la plume de Léon Daudet, cela devient :
Saint-Léger-Léger, dit « le téléphoniste de Stresemann », […] règne encore dans les écuries de feu Aristide-Augias, encombrées de crottin et d’un purin de dix ans[200].
Quand, May 1939, la politique française tentera une alliance avec la Russie, le Cabinet de travail au Ministère sera par Maurras qualifié de « réserve moscoutaire[201] ».
On sent de la part de L’Ami du Peuple, from June Figaro and L’Action française, une détestation toute particulière pour Leger, fondée sur des considérations politiques mais aussi toutes personnelles. Selon Maurras, Leger n’est qu’un « misérable fonctionnaire », un « fauteur de guerre, désorganisateur de nos alliances, brouillon assermenté et peut-être payé, un bandit qui appartient à l’anti-France »[202], en un mot un « malfaisant[203] ».
D’où le verdict : « Son compte commence à être assez bon »[204]. Dès 1937, les communistes réclamaient pour lui la prison[205]. Selon Maurras, il doit être au moins révoqué, au mieux, traduit en justice. « S’il est innocent, il se justifiera » affirme-t-il sans trop y croire. « S’il peut invoquer des circonstances atténuantes tirées de ses tristes maîtres, Briand et Berthelot il les invoquera ». Mais il est clair qu’il mérite « la peine capitale[206] ».
Il arrive à Maurras et Daudet d’être plus expéditifs et de sauter la case « procès » et « prison » :
La place de M. Leger n’est plus au Quai d’Orsay, ministère des Affaires étrangères de la République française, mais à la Caponnière de Vincennes, où, depuis longtemps, son dû consiste à recevoir les douze balles dans son très misérable corps[207].
D’autres, fort nombreux, en d’autres circonstances, ont provoqué Léon Daudet en duel, Leger n’a pas bougé. D’être ainsi « sur la sellette[208] » n’a pu lui être indifférent. Les hommes politiques ont vraiment tous la capacité d’être insensibles aux coups répétés qu’ils reçoivent ? Roger Salengro en 1936, Pierre Bérégovoy plus près de nous, n’ont pas supporté.
Libre à Valery Larbaud, depuis Vichy, de penser que l’affaire n’a pas dû inquiéter son ami. Après l’avoir lui-même, tardivement, découverte dans la presse locale, au moment où Leger avait bénéficié d’un non-lieu, Larbaud a confié que « sans doute, pratiquement, cela n’avait aucune importance pour Leger[209] ». Sans aucun doute ou peut-être ? Qu’en savait-il ? Il était bien loin de Paris pour en juger.
For Leger, les attaques ne portent plus seulement sur son action – ou quelquefois son inaction[210] – elles se sont doublées d’attaques personnelles. On a fouillé dans sa vie. Tel lecteur qui dit avoir bien connu la famille à Pau évoque Alexis comme un garçon intelligent, plutôt littéraire, mais « un peu personnel et infatué[211] ». Under the title (ironique) « Le brave Léger », L’Action française raconte comment, reçu en juin 1914 au concours des consulats, il fut d’abord « embusqué dans les services [then] s’était fait envoyer en Chine où il se jugeait mieux à l’abri des balles[212] ».
Surtout, c’était un créole, « un sinistre créole[213] », un « créole ténébreux[214] », « déliquescent[215] » et donc en tout « plus que suspect », différent donc inférieur ainsi qu’il est couramment admis à l’époque.
Pire, il se pourrait qu’il soit un mulâtre. Au moins, un créole, selon les dictionnaires de l’époque (de moins en moins aujourd’hui) est-il « de pure race blanche », mais un mulâtre, un « sang-mêlé[216] » ! Maurras fait de la question. « Créole ou mulâtre ? » le titre d’un de ses articles[217]. Il lui est arrivé de dire tout net sa pensée à ce sujet :
C’est ainsi que le Chef de Cabinet de Briand, un demi-nègre nommé Léger, [fit] inculper d’espionnage un fonctionnaire de son ministère bien qu’il le sût innocent et en eût la preuve : le document que M. de Noblet était censé avoir livré n’avait jamais quitté son dossier[218] !
Leger a pu ne pas être demeuré insensible aux attaques de tous ordres, répétées, continues, dont il a été l’objet et dont certaines étaient particulièrement blessantes. Léon Daudet et Charles Maurras excellent particulièrement dans le genre. Et qu’on ne dise pas que Leger les ignorait (au sens où il n’en aurait pas eu connaissance), la presse, toute la presse, the Quai d'Orsay, était alors analysée comme à toutes les époques et de nombreuses coupures de L’Action française notamment sont conservées dans tous les dossiers des Archives diplomatiques, dans le dossier personnel de Noblet comme dans les autres.
D’autres affaires, en plus de l’affaire Horan, l’ont également impliqué, pas forcément aussi longtemps et moins directement, ce qui pousse à admettre que la vie du diplomate n’a rien eu d’un fleuve tranquille.
Ces autres affaires sont par exemple celle de la Gazette du franc appelée aussi l’affaire Marthe Hanau, et cette autre, mieux connue, l’affaire Stavisky. Dans l’une et l’autre, le rôle de Leger a été relativement marginal, il s’agit d’autorisations ou de recommandations accordées pour des opérations financières à des personnages qui se révèleront douteux. Marthe Hanau a été arrêtée en décembre 1928 et condamnée en mars 1931 pour escroquerie et abus de confiance, nous sommes alors au début de l’affaire Horan. L’affaire Stavisky éclate un peu plus tard, in January 1934, après la mort dans des circonstances mystérieuses de l’escroc Alexandre Stavisky, c’est l’année où le Conseil d’État a rejeté le pourvoi qu’avait déposé Noblet.
Noblet s’est battu sur plusieurs fronts, Leger de même, cela n’a été confortable ni pour l’un ni pour l’autre. Est-ce que cela a pu aller pour Leger jusqu’à lui faire regretter sa décision, prise à vingt ans, après avoir beaucoup hésité, d’être diplomate ? L’exemple de Claudel l’avait convaincu que la diplomatie permettait de gagner sa vie et d’être en même temps poète.
Être poète et diplomate ?
Est-ce vraiment possible ? Renaud Meltz s’est demandé, à propos de Claudel et Saint-John Perse justement, « Comment peut-on être à la fois ambassadeur de France et poète[219] ? ». La présente recherche tend à prouver que, s’agissant du dernier nommé, cela n’a pas été possible. Et d’envisager qu’il en ait souffert.
Trop exposé. L’aurait-il été moins s’il avait, comme Claudel, été ambassadeur de France dans telle ou telle capitale ? On le sait, Leger a essentiellement exercé ses fonctions au sein de l’Administration centrale, impossible d’y demeurer dans l’ombre dès qu’on atteint un certain niveau de responsabilité. For him, cela a été en 1924 sa nomination à la tête du Cabinet de Briand. Jusqu’à cette date, il a pu se consacrer à la poésie, cela nous a valu Anabasis. Au-delà, plus rien[220].
En novembre 1944, il a confié à son beau-frère Abel Dormoy combien le service de l’État lui a coûté et lui coûterait encore si, par devoir, il lui fallait à nouveau « sacrifier » ce à quoi il aspire le plus, à savoir son « indépendance intellectuelle et morale[221] ». Un an plus tard il le lui répète, « mon vœu le plus intime serait de n’avoir plus rien à faire avec la vie publique. Seul le devoir m’eût fait encore me sacrifier sans compter, en des heures difficiles, au service de l’État[222] ». Un an plus tard encore, il le lui répète une nouvelle fois : « Je ne vois pas en tout cas quelle utilité pour mon pays justifierait le sacrifice de ma situation morale et de mes goûts[223] ».
De quel ordre exactement le sacrifice dont il s’agit dans chacune de ses confidences ? In 1949, au même Abel, il dit regretter son incapacité à « sauvegarder ce minimum de liberté d’esprit que nécessite le travail intellectuel, et que j’ai déjà tant de peine à conquérir sur les difficultés ou les soucis de ma vie quotidienne[224] ».
Il était alors en Amérique, y avait recouvré un certain équilibre et était revenu à l’écriture, ce qui nous a valu ses recueils Winds (dated 1945) et d’abord les poèmes d’Exile (« Exil », « Pluies », "Snow", « Poème à l’Étrangère »), or voilà qu’il s’était retrouvé, après la Libération, dans une situation compliquée qui l’empêchait à nouveau de composer l’œuvre qu’il portait en lui. La France n’était plus occupée, devait-il y revenir, comment y serait-il accueilli, quel poste lui serait offert ?
Le « travail intellectuel » auquel ces questions qui l’assaillaient l’ont empêché de se consacrer pendant plusieurs années ne paraîtra qu’en 1957, ce sera Seamarks. Il ne put en rédiger que quelques fragments : in 1948, un premier fragment sous le titre « Poème » (c’est le chant VII de la strophe), in 1950, deux autres fragments, « Et vous mers…. » et « Invocation ». Il ne pourra s’y consacrer que lorsque ses principaux problèmes seront derrière lui, quand il sera en retraite (from 1950) et n’aura plus à se soucier de retrouver un poste, quand il aura décidé de n’être plus « que » poète. Autre décision arrêtée, celle de revenir en France où une demeure lui a été trouvée en bord de mer.
Début novembre 1951, il insistait encore dans une de ses lettres à ses sœurs, sur « les difficultés et soucis de toute sorte auxquels [il avait] à faire face, pour le présent et l’avenir ». Dans une lettre adressée en 1950 à son beau-frère Abel Dormoy, il avait précisé la conséquence majeure de l’état où il se trouvait :
J’ai sacrifié en effet, comme trop intime, l’œuvre à laquelle je travaillais depuis deux ans[225].
En diverses autres circonstances, il répétera avoir absolument besoin d’un « minimum de liberté d’esprit » pour écrire, il l’avait confié à son beau-frère Abel en 1949, il le répétera à sa sœur Éliane en 1963 :
Je voudrais bien sortir de tout cet assombrissement où me tiennent encore tant d’incertitudes devant moi. Je n’arrive pas à retrouver ma liberté d’esprit pour le travail de création littéraire que j’avais en train[226].
Ce même sacrifice a duré aussi longtemps qu’il a été diplomate. Autres soucis mais même résultat. Pour peu qu’on donne toute sa force au mot « sacrifice » tant de fois répété, force est de constater que le poète n’a jamais été aussi proche qu’alors de l’aveu de sa souffrance.
Il l’a tue, il a préféré affirmer avoir choisi librement de publier sous pseudonyme pour éviter toute interférence de son ancienne vie de poète avec son activité de diplomate. Cette posture d’un homme maître de lui comme de l’univers est certes flatteuse, en fait, la décision s’est imposée à lui, il a tiré les conséquences d’une impossibilité.
Une impossibilité dont il a dû souffrir d’autant plus qu’il trouvait dans la presse de nombreuses allusions et références à son œuvre poétique ancienne, qu’elles soient positives ou non, qui sont pour lui autant de rappel de sa vocation inassouvie.
Il a souhaité masquer auprès de ses collaborateurs, même les plus proches tel Étienne de Crouy-Chanel, son Secrétaire, qu’il avait été poète, en réalité, les poèmes d’Praises, Anabasis, les noms de Saintléger-Léger et de Saint-John Perse sont régulièrement associés à son nom dans la presse du temps. Il n’a jamais pu dans ces conditions être détourné de penser à ce qui lui importait plus que tout.
Certains journaux ont affirmé que la poésie pour lui n’était qu’un violon d’Ingres, un divertis-sement, qu’il excellait dans le pastiche, autrement dit que la poésie n’était qu’un jeu. Hélas pour lui, ce n’en était pas un jeu, d’où selon nous sa souffrance.
Il a réussi à se faire identifier par la postérité sous les traits d’un aventurier du monde et de l’esprit : l’image d’un Leger anxieux et menacé dans sa vie tranche avec ce qui n’était qu’un masque. Sa plus proche amie américaine, Katherine Biddle, dans son journal intime, en a témoigné, lui-même s’est montré sans masque dans ses lettres à ses sœurs et beau-frère. Alexis Leger était un inquiet.
Inquiet de l’avenir toujours, inquiet quant à son statut de résident américain, quant à l’accueil qui lui serait réservé s’il rentrait en France, inquiet sur le versement de sa bourse et ses moyens de subsistance. Même aux moments où il n’était pas sans ressources, il craignait de devoir bientôt en manquer, ses lettres à ses sœurs en témoignent clairement[227]. Comme diplomate il s’est régulièrement inquiété pour son poste à chaque changement de gouvernement, et même aux moments où l’affaire Horan ne faisait pas la Une des journaux, il savait que cela n’allait pas durer.
Aussi longtemps qu’il a été diplomate, le poète a été dans la situation évoquée par Baudelaire au début des Fleurs du mal dans « Élévation ». Il savait que, loin des « ennuis et [d]es vastes chagrins / Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse », il est une « immensité profonde » qui attend qu’on la sillonne gaiement « avec une indicible et mâle volupté »… Encore faut-il le pouvoir.
Heureux celui qui peut, d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins !.
From Anabasis, Alexis Leger ne l’a pu. Il est douteux selon nous que la réussite de sa carrière, la rapidité de son ascension jusqu’au poste suprême de la diplomatie française, les honneurs dont il a été comblé, aient pu compenser ce manque.
Une confidence du poète bien connue prend un singulier relief quand on pense à ce qu’a été sa vie de diplomate :
À la question posée : "Why do you write? », la réponse du Poète sera toujours la plus brève : « Pour mieux vivre ».
À l’époque où il écrit ces lignes, il est redevenu poète et compare sa vie à ce que serait une vie sans l’écriture… In fact, il parle d’expérience : quand a-t-il été le plus longuement empêché d’écrire, quand a-t-il le moins bien vécu, sinon pendant toutes ces années où l’affaire Horan, quel que soit le nom qu’on lui donne, l’a assailli ?
Il n’est pas indifférent d’observer que son œuvre, si optimiste soit-elle, s’adosse à une réalité qui a pu être plus douloureuse qu’on ne croit.
Libre au lecteur de ne s’attacher qu’à l’œuvre altière de Saint-John Perse et de tout ignorer de ce que fut la vie d’Alexis Leger, y compris de sa vie de diplomate. Mais libre aussi à lui de ne rien s’interdire et au besoin de s’appuyer… sur l’exemple du poète lui-même qui, dans son Pléiade, a livré tant d’informations personnelles à tant de ses proches et à tous ses futurs lecteurs.
L’affaire Horan ? Qu’il s’agisse du poète ou du diplomate, toujours, « c’est de l’homme qu’il s’agit, dans sa présence humaine ».
——
[1] Selon les propres termes de SJP dans le volume de ses Complete Works, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1972, p. xviii. AL, qui vient d’entrer dans la carrière, doit d’avoir été invité à l’amitié de Berthelot plus qu’à son expérience et ses compétences.
[2] Signé le 27 août 1928, il entrera en vigueur le 24 July 1929. Kellogg seul se verra attribuer le prix Nobel de la paix à la fin de l’année mais Briand, qui l’avait déjà reçu en 1926 avec Stresemann, y fut associé. On le verra, l’affaire Horan était trop modeste et anecdotique, finalement trop franco-française, pour qu’en résulte une rupture avec l’esprit du temps.
[3] Le Petit Parisien, 22 September 1928.
[4] Oreste Rosenfeld, « Le scandale du compromis naval. Qu’attend-on pour publier le texte complet de l’accord », Le Populaire, 24 September 1928.
[5] The Uncompromising, 23 September 1928.
[6] The Work, 23 September 1928.
[7] La Dépêche du Berry, même date.
[8] O. Rosenfeld, Le Populaire, 24 September 1928.
[9] Orson Welles s’en est inspiré pour son Citizen Cane. Sur Hearst, voir sa notice en annexe X, p. 192.
[10] Traduction dans Le Journal from June 22 September 1928 and Le Progrès de la Côte d’Or from June 23. Titre original: « Two Nations in Agreement Against the United States – French Foreign Office letter shows the American contention regarding cruisers and guns is disregarded ».
[11] Time, 23 September 1928.
[12] La Dépêche du Berry, 30 September 1928.
[13] Le Populaire, non signé, « Des bruits étranges », 28 September 1928.
[14] Id., « Le roman du compromis naval », article signé par Léon Blum lui-même, 5 th 1928. Souligné dans le texte.
[15] Certains journaux étrangers, notamment le Hamburger Nachrichten et le Daily News, ont formellement accusé le gouvernement français « d’avoir communiqué lui-même le document afin de forcer la main à l’Angleterre par sa publication » (S. Sailly, op. cit., L’Information sociale, Thursday 18 th 1928).
[16] Communiqué du ministère français des Affaires étrangères en date du 22 September 1928, dans tous les journaux du lendemain, quelquefois sous le titre « La mise au point de M. Briand » (Le Progrès de la Côte d’Or, 23 September 1928).
[17] Cross, 23 September 1928.
[18] Henry Barde, The Work, mercredi 10 th 1928, Bonsoir, Thursday 11 th 1928. Les archives diplomatiques permettent de préciser la date de cette première rencontre, the 4 th. Elle sera suivie de deux autres, le lendemain et surlendemain.
[19] Le dossier personnel de Noblet aux Archives diplomatiques donne tous les détails désirables. Paul Bargeton, Chef du service de la presse, à la demande de Leger, a interrogé, ses collaborateurs présents à Paris et a écrit à ceux qui étaient en vacances, parmi ceux-ci, the 3 th, Jean de Noblet, absent de la capitale depuis le 15 September. Auparavant, Noblet avait remplacé Bargeton à la tête du service pendant les vacances de celui-ci. Noblet lui a répondu n’avoir rien remarqué de suspect pendant son intérim.
[20] « Mr. Horan was again called to the Foreign Office on Saturday, after Embassy Officials here had interceded in his favor » (« M. Horan a de nouveau été appelé au ministère des Affaires étrangères samedi après que les fonctionnaires de l’ambassade eurent intercédé en sa faveur »), International Herald Tribune, Paris, on Tuesday 9 th 1928.
[21] In fact, c’est encore Bargeton, Directeur du service de la presse, qui a reçu Horan. Les Archives diplomatiques conservent le compte-rendu de ses rencontres avec Horan, les jeudi 4, Friday 5 and Saturday 6 th 1928. Horan y a impliqué Hearst et reconnu avoir transmis le document à New York. À aucun moment il n’a évoqué d’éventuelles complicités au sein du Ministère. Il a accepté d’être expulsé et promis de partir comme volontairement après avoir obtenu qu’aucun mandat d’expulsion ne soit émis contre lui, ce qui aurait pu nuire à sa carrière.
[22] Titre de l’International Herald Tribune, on Tuesday 9 th 1928.
[23] Lucien Zimmer (op. cit.) se trompe quand il date l’interpellation de Horan du samedi 6 th 1928.
[24] « As the rumor of Horans’s arrest spread, newspapermen tapped the highest sources in the Foreign Office, all to no avail. All officials expressed entire surprise », The Nassau Daily Review, Freeport, État de New York, on Tuesday 9 th 1928.
[25] « The Quai d’Orsay denied that it knew anything about the matter whatsoever », The Chicago Tribune and the Daily News, Europe’s American Newspaper, Paris, mercredi 10 th 1928.
[26] Jean-Gabriel Lemoine, « Les indiscrétions sur l’accord franco-anglais », L’Écho de Paris, on Tuesday 9 th 1928.
[27] Le Journal, on Tuesday 9 th 1928.
[28] J. C. MacDonald, International Herald Tribune, Thursday 11 th 1928.
[29] Relevé effectué, inter alia, by The Nassau Daily Review, Freeport, État de New York, on Tuesday 9 th 1928.
[30] New York Times, 26 août 1985.
[31] « This is the first time that an American correspondent has been expelled in connection with his professional activities », International Herald Tribune, Paris, on Tuesday 9 th 1928.
[32] « L’opinion de M. Coolidge, Washington, 9 th 1928 », The Work, mercredi 10 th 1928.
[33] L’Ouest-Éclair, Thursday 11 th 1928.
[34] Le Petit Journal, Friday 12 th 1928, Time, Saturday 13, d’après une dépêche de l’agence Havas.
[35] « Ce qu’on en pense au Quai d’Orsay », L’Écho de Paris, mercredi 10 th 1928.
[36] Henry Barde, The Work, mercredi 10 octobre1928.
[37] L’Ouest-Éclair, Thursday 11 th 1928.[38] Id, ibid.
[39] « La presse parisienne défend Horan », Chicago Tribune and the Daily News, Paris, 10 th 1928.
[40] Berliner Tageblatt du mardi 9 th 1928, cité par L’Ami du Peuple and L’Action française from June 11.
[41] « L’expulsion de Horan différée », Journal des Débats, 12 th 1928.
[42] Texte intégral du communiqué le 11 th 1928 in La Gazette de Biarritz-Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, the 12 dans tous les autres.
[43] Morning, Friday 12 th 1928.
[44] Le journal a vraisemblablement été informé par téléphone, et non par une dépêche d’agence, ce qui expliquerait qu’il ait été le premier à donner l’information mais aussi que le nom de Roger Deleplanque ait été mal transcrit (devenu Georges de Leblanque).
[45] Voir la notice sur Deleplanque et Noblet en annexe X, p. 195 and 196.
[46] « La lumière est faite », Le Petit Journal, 14 th 1928.
[47] Comment et par qui les documents furent-ils remis à M. Horan, L’Écho de Paris, 13 th 1928.
[48] « Les fuites du Quai d’Orsay », Le Petit Journal, 12 th 1928. Même texte le même jour dans La Rumeur and in The Work.
[49] « Quelles sont les personnes qui auraient livré le document confidentiel du Quai d’Orsay ? », Le Journal, 12 th 1928.
[50] « La dignité nationale dans la boue », Centre-Express, même jour.
[51] « On connaîtrait le nom de la personne qui a livré le document à M. H. Horan », Le Quotidien, Friday 12 th 1928. Souligné dans le texte.
[52] « Le journaliste Horan tenait le document sur l’accord naval de plusieurs personnes dont il a donné les noms », Le Petit Parisien, Friday 12 th 1928.
[53] Le Peuple, Sunday 14 th 1928.
[54] La date est notamment donnée par Morning from June 14 th 1928.
[55] Holger Christian Holst, « Le jeune Alexis Leger/Saint-John Perse vu par Karen Bramson », Postérités de SJP, Actes du colloque international de Nice, 4-6 mai 2000, Presses Universitaires de Nice, 2002. In 1932 K. Bramson avait fait paraître, en français, un roman, Un seul homme, dont le personnage principal présente trop de similitudes avec AL pour qu’on invoque des coïncidences.
[56] « C’est le publiciste Roger Deleplanque qui livra à Horan les documents secrets », Le Petit Parisien, 14 th 1928, cité par Pierre Tuc dans L’Action française le lendemain.
[57] « Comment et par qui les documents furent-ils remis à M. Horan », L’Écho de Paris, 13 th 1928.
[58] « L’affaire du document sur le compromis naval », Le Journal, 14 th 1928.
[59] Sous-titre de l’article « Les circonstances dans lesquelles le document secret fut remis à M. Harold Horan », Le Phare de la Loire et de la Haute-Loire, 14 th 1928.
[60] « La lumière est faite. / Le document publié par M. Horan lui a été remis par un journaliste français », Le Petit Journal, 14 th 1928.
[61] La même formule se retrouver dans la plupart des journaux du 14 th 1928.
[62] Au hasard, Tuesday 16 th 1928, L’œuvre, La Dépêche, La Gazette de Bayonne, etc., et encore Bonsoir le jeudi 18.
[63] L’Écho de Paris, 13 th 1928. Même affirmation, au mot près, in La Patrie du lendemain sous le titre « Le document volé au Quai d’Orsay ».
[64] The Work, mercredi 17 th 1928.
[65] « L’affaire Horan se termine par la disculpation des deux collaborateurs accusés ».
[66] Onze feuillets selon Time from June 18 th 1928, neuf seulement selon Le Petit Journal from June 3 novembre suivant. La durée de l’absence de Noblet est donnée dans Morning from June 14 th 1928, reprise par L’Action française le lendemain. Auparavant, the 13, Morning avait d’abord affirmé que Noblet avait carrément quitté le Ministère et laissé Deleplanque seul dans son bureau pendant « deux ou trois heures », ce qui est assez invraisemblable. Selon Time from June 18, Deleplanque aurait « profit[it is] d’une absence momentanée de M. de Noblet, appelé au téléphone dans un bureau voisin ». Une conversation qui aurait duré une heure et demie ? Cela en soi est peu vraisemblable. La presse a bien du mal à crédibiliser la thèse d’une copie sur place du document par Deleplanque.
[67] Communiqué notamment reproduit in extenso the 18 th 1928 dans le Journal des Débats, Time, Cross, Bonsoir and L’Information sociale, résumé ailleurs.
[68] Briand a fait cette déclaration le 18 janvier 1927 devant le Conseil des ministres, ajoutant : « Comment pourrait-il en être autrement ? ». Les négociations étaient alors en panne et il exprimait un vœu et non un constat. Indeed, les négociations avaient repris ». Elle est publiée par Jean Luchaire dans La Volonté du lendemain.
[69] Le site French (gratuit) et maintenant le site Retronews (payant), gérés l’un et l’autre par la BNF, rendent accessibles, dans une version digitalisée, nombre de journaux et revues, et sont dotés, above all Retronews, d’un moteur de recherche pratique et performant. Des outils équivalents existent pour la presse anglophone.
[70] Le Gaulois, L’Ère nouvelle, Friday 12 th 1928.
[71] Le Journal des Débats, Friday 12 th 1928. Le journal a trouvé l’information… dans L’International New York Herald de la veille (qui paraît à Paris), et regrette que les journalistes américains aient en la circonstance été mieux traités que les Français.
[72] Déjà cité p. 32.
[73] International Herald Tribune, Paris, Thursday 11 th 1928.
[74] Excelsior, Friday 12 th 1928. La Justice à cette date n’a pas encore été saisie, la formule « action judiciaire » renvoie à la Police judiciaire.
[75] Il clamera pourtant partout son innocence. On verra plus loin que des réserves peuvent être émises sur la réalité de ces aveux, d’où l’emploi ici du conditionnel.
[76] On verra plus loin qu’une autre raison a expliqué la décision de Briand et Leger de se tourner vers la Justice.
[77] Morning, on Tuesday 16 th 1928.
[78] Le Journal des Débats, mercredi 17 th 1928.
[79] « À la fin de l’après-midi [Monday 15 th], Mrs. Aristide Briand, de retour à Paris, a conféré avec M Philippe Berthelot et M. Alexis Léger au sujet des résultats de l’enquête administrative relative à l’affaire Horan », Morning, on Tuesday 16 th 1928.
[80] « M. Briand a été mis en possession du dossier de l’affaire Horan, qu’il connaissait déjà d’ailleurs », L’Ouest-Éclair, La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, Le Petit Marseillais, 16 th 1928.
[81] Ce compte rendu de l’interrogatoire de Horan signé par l’intéressé, figure dans le dossier personnel de Noblet aux Archives diplomatiques, ainsi que la version qui en a été communiquée à la presse, ils sont est reproduit en annexe I, p. 163 et II, p. 166.
[82] Humanity, 3 November 1928.
[83] Le Petit Bleu de Paris, 14 th 1928.
[84] « M. de Noblet par ordre se tait », Bonsoir, on Tuesday 16 th 1928.
[85] Le Figaro, 24 août 1929. À cette date, à l’occasion du non-lieu dont il vient de bénéficier, Noblet se juge autorise à s’exprimer dans la presse puisque son Administration elle-même a communiqué sur le sujet.
[86] L’Action française, 14 th 1928. Les Archives diplomatiques conservent le procès-verbal de l’interrogatoire de Noblet, signé par lui. On y voit clairement, entre autres procédés, comment des hypothèses lui sont suggérées, hypothèses que Noblet accepte d’envisager et qui, sorties de leur contexte, seront présentées comme des aveux spontanés. Voir l’extrait de procès-verbal reproduit en annexe III, p. 169.
[87] Communiqué publié notamment dans Le Populaire Saturday 13 th 1928.
[88] Le rapport de Jules Basdevant conclut « que la loi de 1886, visant la divulgation des secrets intéressant la défense nationale ne pouvait être invoquée », L’Action française, 7 août 1930. Le rapport est présent dans le dossier personnel de Noblet aux Archives diplomatiques.
[89] L’information est dans tous les journaux le 25.
[90] La Dépêche, Toulouse, 27 December 1928.
[91] Signé Intérim, Le Figaro, 21 août 1928.
[92] Aux Écoutes, Saturday 27 th 1928. La rumeur d’un dessaisissement du juge Girard est donc ancienne (the 27 th, il n’en a été saisi que depuis quatre jours). On s’est apparemment immédiatement aperçu au Parquet que Girard était effectivement un « juge sévère » et qu’il ne serait pas aisé de le manipuler.
[93] L’Ami du Peuple, 30 août 1929.
[94] L’Action française, 1er September 1929. En réalité huit mois, de la fin décembre à la fin août.
[95] L’Action française, 16 août 1930.
[96] Charles Maurras, L’Action française, 1er September 1929.
[97] Entre autres Le Petit Parisien and L’Avenir the 21 août 1929, L’Homme libre, Le Populaire, The Uncompromising the 22.
[98]Journal des Débats, L’Ère nouvelle, La Dépêche, Le Nouvelliste de Bretagne, La Dépêche de Brest, Centre-Express.
[99] La Croix du Nord.
[100] Time, The Work, L’Ami du Peuple, Excelsior, Humanity.
[101] L’Avenir, Le Petit Parisien.
[102] Titre de L’Ami du Peuple, 3 November 1928 : « De qui se moque-t-on ? / À l’instruction l’affaire Horan apparaît comme une bagatelle / MM. De Noblet et Deleplanque confrontés hier ».
[103] Time, Le Journal des Débats, 22 août 1929.
[104] Au hasard, à partir du 21 août, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Populaire, The Uncompromising, L’Avenir, L’Homme libre Paris, Le Progrès de la Somme, Le Petit Troyen, Le Patriote des Pyrénées en province.
[105] L’Ère nouvelle, 21 août 1929
[106] St. Louis Post-Dispatch, Missouri, 16 November 1929. « Un magistrat instructeur a décidé qu’il n’y avait aucun motif de poursuite du chef d’accusation d’espionnage et complot contre la sécurité de l’État ».
[107] L’Action française, 21 août 1929 (souligné dans le texte).
[108] Cette lettre ne figure pas dans son dossier aux Archives diplomatiques, nous ne la connaissons que par ce qu’il en dit dans une autre lettre à Briand, en date du 29 août, qui elle y figure.
[109] Voir le texte intégral de cette déclaration en annexe IV, p. 171.
[110] Les premiers avocats, aussi bien ceux de Deleplanque que Me Campinchi qui défend Noblet, sont politiquement marqués à gauche.
[111] La déclaration de Noblet à la presse est reproduite en annexe IV, p. 171. Elle a paru à partir du 23 août 1929 in Le Journal des Débats, L’Écho de Paris, L’Ami du Peuple, La Volonté, L’Action française bien sûr et Le Figaro, et en province entre autres dans Le Progrès de la Somme, L'Express du Midi and La Dépêche.
[112] Journal des Débats, 7 September 1929, L’Action française and Le Figaro du lendemain.
[113] Noblet « s’estime insuffisamment lavé par un non-lieu qui disculpe en même temps que lui un personnage qui avait reconnu sa faute », L’Ami du Peuple, 25 août 1929.
[114] L’Action française, 21 août 1929. « Is fecit cui prodest », le criminel est celui à qui le crime profite.
[115] Comoedia, 28 September 1929.
[116] La Libre Parole Républicaine, 7 March 1929.
[117] Cette nouvelle lettre à Briand est conservée aux Archives diplomatiques mais n’a pas été publiée. Puisque nous avons pris le parti de nous placer du point de vue des contemporains, nous ne la citerons pas ici mais on pourra la lire en annexe V, p. 173. Noblet y fait encore preuve d’une certaine modération en n’évoquant que ses plaintes contre la Police et non celles contre son Administration.
[118] Sur le nouvel avocat de Noblet, Mrse Scapini, fort marqué à droite à la différence du précédent, Mrse Campinchi, voir sa notice en annexe X, p. 190.
[119] Excelsior and Le Petit Journal, 23 janvier 1930.
[120] Par exemple Le Journal, La Dépêche, Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire.
[121] Journal des Débats, 17 November 1929.
[122] L’Action française, Le Figaro, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Morning, L’Ami du Peuple, La Volonté, the 23 November 1929, Le Journal des Débats and Cross the 24, Le Phare de la Loire et une seconde fois L’Action française the 26, L’Avenir des Hautes-Pyrénées the 1er December.
[123] Noblet a bien adressé une troisième lettre à Briand, the 12 th 1929, accompagnée d’un long rapport confidentiel, qui tous deux mettent en cause explicitement AL. Rien n’a été publié et personne n’en a eu connaissance à l’époque. Les deux pièces sont conservées dans le dossier personnel de Noblet aux Archives diplomatiques. Nous les reproduisons en annexe VI, p. 175 et VII, p. 177.
[124] La mise en cause explicite de Leger a rendu impossible sa publication de ces deux pièces dans la presse.. Nous les reproduisons en annexe VI, p..175 et VII, p. 177.
[125] Le Journal des Débats, 16 November 1929. L’information est aussi donnée le même jour dans Le Figaro and The Work et les jours suivants en province.
[126] Le Populaire, Le Petit Parisien, Morning and L’Ami du Peuple the 23 November 1929, Le Phare de la Loire the 26.
[127] L’Ami du Peuple, 8 avril 1930.
[128] Le Petit Journal, 18 November 1930.
[129] Souligné par nous.
[130] Sur Philippe Lussan, voir sa notice en annexe X, p. 190.
[131] Il en sera question plus loin.
[132] Souvent écrit Brack, ou Bracke, quelquefois Braque, Brecq et même Pyrack. Voir sa notice et celle de Me Jallu en annexe X, p. 191 and 190.
[133] Léon Daudet, L’Action française, 9 avril 1930.
[134] Faux-Pas-Bidet a été chargé de l’enquête sur l’enlèvement à Paris, in January 1930, du général Alexandre Koutiepov (en russe : Куtепов), un Russe blanc émigré en France depuis 1924. Voir sa notice en annexe X, p. 192. Comme l’affaire Horan et en même temps mais pendant moins longtemps (toute l’année 1930), l’affaire Koutiepov a beaucoup occupé les journaux.
[135] Son nom est la transcription phonétique de son patronyme en chinois (il est né à Rennes dans une famille d’immigrés venus de Shangaï).
[136] Léon Daudet, L’Action française, 18 mai 1931.
[137] Faux-Pas-Bidet a aussi interrogé Deleplanque. Voir sa notice en annexe X, p. 192.
[138] Selon Léon Trotsky dans La Guerre et la révolution, tome II, 1924.
[139] Morning, Thursday 25 th 1928.
[140] Le Petit Parisien, The Work (qui écrit « Faux-Pasbidet » comme Le Figaro), Le Journal, Le Populaire, Excelsior, Saturday 12 July 1930.
[141] Le caractère non-secret du document est maintenant rappelé dans la plupart des journaux.
[142] Friday 5 th 1928 in L’Écho de Paris.
[143] L’Action française Friday 11 July 1930 pour les deux premières citations, Le Figaro du lendemain pour la dernière.
[144] Les rapports entre Briand et Barthou sont exécrables. « Il faut savoir qu’entre le [Thursday] 18 et le [mercredi] 24 th [1928], le ministre de la Justice avait refusé par deux fois d’ouvrir une enquête judiciaire contre M. de Noblet. Briand à deux reprises l’avait exigée. Il finit par l’obtenir de M. Barthou » (L’Action française, 24 July 1930).
[145] L’Action française, Saturday 12 July 1930.
[146] L’Action française, Friday 11 July 1930, cité par Le Figaro le lendemain. Les majuscules sont dans le texte.
[147] L’Action française, 25 July 19301
[148] Le ministre de la Justice est alors Raoul Péret (from June 2 March till 16 November 1930). Plusieurs fois ministre depuis 1913, notamment ministre des Finances dans un gouvernement Briand en 1926, il a été aussi Président de la Chambre des députés en 1926-1927. Son implication dans l’affaire Oustric a causé la chute du gouvernement Tardieu.
[149] Titre de L’Action française Saturday 12 July 1930.
[150] Le Journal, The Work, Saturday 12 July 1930.
[151] Le Figaro, 14 July 1930.
[152] Excelsior, L’Écho de Paris, Le Phare de la Loire, Le Petit Courrier, même jour.
[153] Le Petit Parisien, id.
[154] Morning, id.
[155] La Petite Gironde, id.
[156] L’Ami du Peuple, id.
[157] Le Quotidien, id.
[158] Le Populaire, id. Souligné par nous.
[159] La Chambre des mises en accusation est, d’entre toutes les Chambres de la Cour d’appel, la juridiction d’appel en matière d’instruction. À ce titre, elle a à connaître de tous les incidents relatifs aux instructions ainsi que des recours exercés contre les ordonnances du Juge d’instruction et contrôle la bonne marche des instructions et de la légalité des actes d’instruction. Elle siège à huis clos. On l’appelle souvent à l’époque simplement Chambre des Mises.
[160] The 23 July 1930, Noblet avait fait distribuer un mémoire sur son affaire « à Messieurs les Président et Conseillers composant la Chambre des mises en accusation » (consultable aux Archives diplomatiques).
[161] Une caponnière est un chemin enterré qui, dans une enceinte fortifiée, permet le passage d’un ouvrage à l’autre (Trésor de la langue française). Le Duc d’Enghien en 1804 a été exécuté dans le fossé de Vincennes.
[162] In 1939, L’Action française assumera personnellement et dans les mêmes termes ses menaces de mort, aux dépens de Leger cette fois, sans se protéger comme il fait en citant une feuille locale (cf. p. 150).
[163] L’Action française, citant Noblet lui-même, 20 February 1931 : « Le chef de cabinet de M. Briand organisa avec la préfecture de police une odieuse intervention policière ».
[164] L’Écho de Paris, Le Quotidien, L’Ère nouvelle, Le Journal, The Work, Cross, Bonsoir, Excelsior, etc.
[165] Le Petit Parisien, Morning, Le Populaire, Le Petit Journal, L’Ouest-Éclair, Le Phare de la Loire, etc.
[166] L’Action française, 30 July 1930.
[167] Louis Marin (1871-1960), député (droite parlementaire conservatrice), plusieurs fois ministre sous la IIIème République, a présidé bien d’autres commissions.
[168] Elle est reproduite en annexe VIII, p. 183.
[169] L’Action française, 27 avril 1931.
[170] Cyrano, 1er March 1931.
[171] Nul n’évoque par exemple le fait que Noblet et son avocat, Mrse Jallu, ont distribué à tous les députés, the 16 avril 1931, un épais mémoire sur l’affaire. Il est consultable aux Archives diplomatiques.
[172] L’Action française, 27 avril 1931.
[173] Le Figaro, 2 mai 1931.
[174] Excelsior, 22 March 1934 (après que le Conseil d’État eut enfin statué sur son sort).
[175] Le Petit Parisien from June 30 avril 1931 et la plupart des journaux. Il n’est guère que Paris-Soir qui explique la sanction par la fuite du document publié aux États-Unis. Quelques-uns annoncent la révocation de Noblet sans aucun commentaire, for example Le Soir, Cross, Le Petit Bleu de Paris and La Tribune de l’Aube, etc.
[176] The Work, Le Figaro, Le Petit Journal, L’Écho d’Alger, Friday, May 11 July 1931.
[177] The Work, 14 November 1931.
[178] Id., ibid.
[179] Abel Manouvriez, L’Action française, même date.
[180] Léon Daudet, in L’Action française du mardi 9 th 1932, a rappelé en vain que Noblet avait été la victime d’une machination montée par Berthelot et Leger.
[181] Excelsior, 22 March 1934.
[182] Id. Outre Excelsior, la lettre est aussi, le même jour, qualifiée d’impertinente par The Work, Le Journal and Le Petit Journal, by Time le lendemain.
[183] Morning, 22 March 1931.
[184] The Work, Friday 11 July 1931, L’Écho d’Alger du lendemain.
[185] The Work, id.
[186] Lettre de Noblet au Rédacteur en chef de Morning, publiée le 28 March 1934.
[187] Confidence tardive dans Time, 29 mai 1935.
[188] Cette lettre du 12 th 1929 et le rapport confidentiel qui lui était joint figurent dans le dossier personnel de Noblet aux Archives diplomatiques. Les deux pièces sont reproduites en annexe VI, p. 175 et VII, p. 177.
[189] Lapsus pour « impartialité » ?
[190] Le Figaro, 2 mai 1934.
[191] Id., ibid., 29 mai 1938.
[192] L’Action française, 10 December 1938.
[193] Sur ce que sont devenus les protagonistes de l’affaire, voir la notice de chacun en annexe X, p. 190 et suiv.
[194] Lettre de Noblet du 27 September 1943 au Rédacteur en chef de La France nouvelle, Buenos Aires, 7 th 1943.
[195] Il aurait même pu rencontrer Horan (cf. p. 194).
[196] Président du Conseil sans discontinuer de juillet 1926 à janvier 1932 (onze fois en tout depuis 1909), douze fois ministre des Affaires étrangères depuis 1911 (la dernière fois de juillet à novembre 1929), plusieurs fois l’un et l’autre en même temps
[197] L’affaire a été « épouvantable » pour Noblet (cf. annexe X, p. 197) ainsi que pour toute sa famille (cf. sa lettre au Président de la Ligue des Droits de l’Homme du 8 December 1936 partiellement citée en annexe IX, p. 189).
[198] Gilbert Peycelon, Directeur des publications officielles de la République française, ami très proche de Briand, très présent dans son cabinet sans pourtant y avoir été nommé, a partagé un temps le bureau de Leger. Cyrano qualifie les deux hommes d’ « anges tutélaires de Briand » (25 janvier 1931).
[199] Paul Bargeton, Chef du service de la presse au Quai d’Orsay.
[200] L’Action française, 20 November 1933.
[201] Ibid., 1er mai 1939.
[202] Ibid., 4 mai 1939.
[203] Ibid., 12 July 1939.
[204] Ibid., 1er mai 1939.
[205] Gabriel Péri, Humanity, cité par Le Figaro, 16 June 1937.
[206] Ibid., 9 mai 1939.
[207] Charles Maurras, ibid., 7 July 1939, répété le 25 août.
[208] Aux Écoutes, 27 December 1930.
[209] Valery Larbaud, cité par R. Meltz, op. cit., p. 279.
[210] « Ah ! Quel dormeur ! Quel crétin de dormeur ! Ces crétins de dormeurs nous ont mis dans l’impasse de leur conception politique toute doctrinaire » (ibid., 21 mai 1939).
[211] L’Action française, 4 mai 1939.
[212] Ibid., 30 March 1939.
[213] Ibis., 18 September 1935.
[214] Ibid., 6 March 1934.
[215] Ibid., 19 September 1934, répété le 2 June 1935.
[216] Ibid., 4 mai 1939.
[217] Ibid., 1er mai 1939.
[218] Charles Maurras, « L’affaire Horan, Hearst, Berthelot », Ibid., 1er September 1929.
[219] Titre exact de son étude : « Paul Claudel et Alexis Léger : comment peut-on être à la fois ambassadeur de France et poète ? », Seminar Claudel politique from 2003, textes réunis par Pascal Lécroart, préface de Jacques Julliard, Aréopage, 2009.
[220] Sauf à croire à l’existence de toutes ces œuvres que, selon lui, les Allemands auraient saisies dans son appartement parisien en juin 1940 avant de le mettre à sac, ce dont on est autorisé à douter depuis qu’on sait que ses sœurs et beau-frère ont pu récupérer, dans un appartement intact, tous ses meubles, vêtements et papiers. Cf. Lettres familiales 1940-1957, Les cahiers SJP, No. 22,
Gallimard, 2015, passim.
[221] AL à Abel Dormoy, Lettres familiales, op. cit., 1er November 1944, p. 40.
[222] Ibid., 7 mai 1945, p. 45.
[223] Ibid., 25 February 1946, p. 84.
[224] Ibid., 9 November 1949, p. 149.
[225] AL à Abel Dormoy, Lettres familiales, op. cit., 11 February 1950, p. 155.
[226] AL à Éliane Leger, 24 November 1963, Lettres familiales, op. cit. p. 345. On ignore à quel poème travaillait AL à l’été 1963 (Birds a paru en 1962 and Chanté par celle qui fut là… ne paraîtra qu’en janvier 1969). On ignore quels étaient alors les soucis qui l’empêchaient de s’y consacrer.
[227] See Lettres familiales, op. cit., passim.